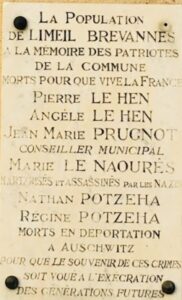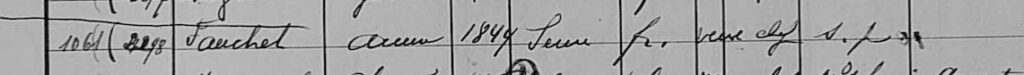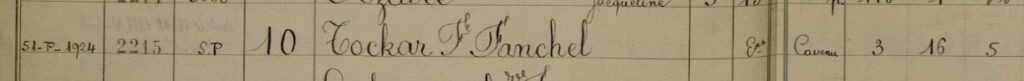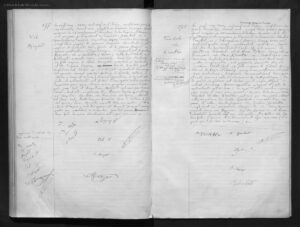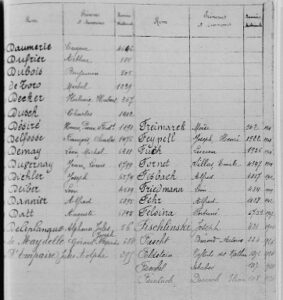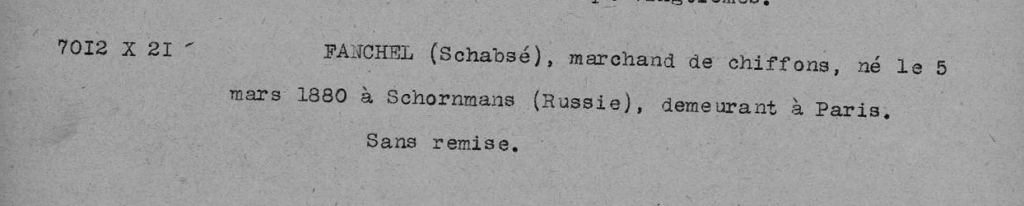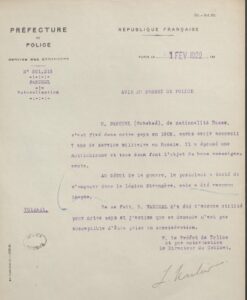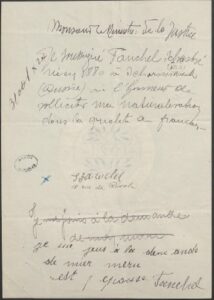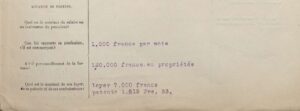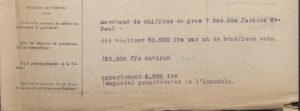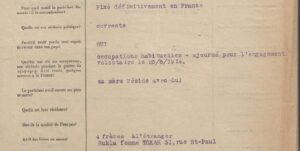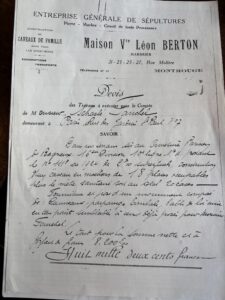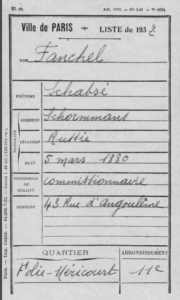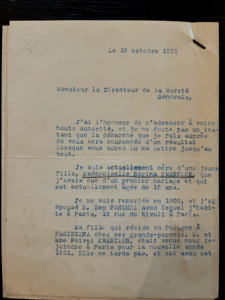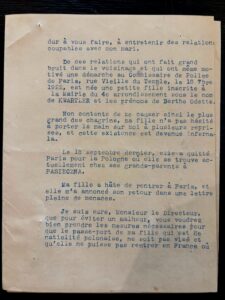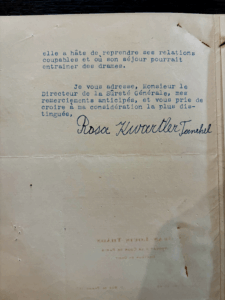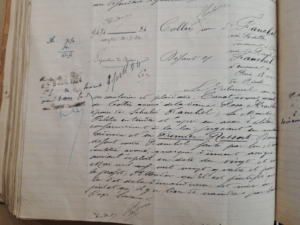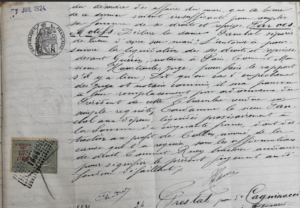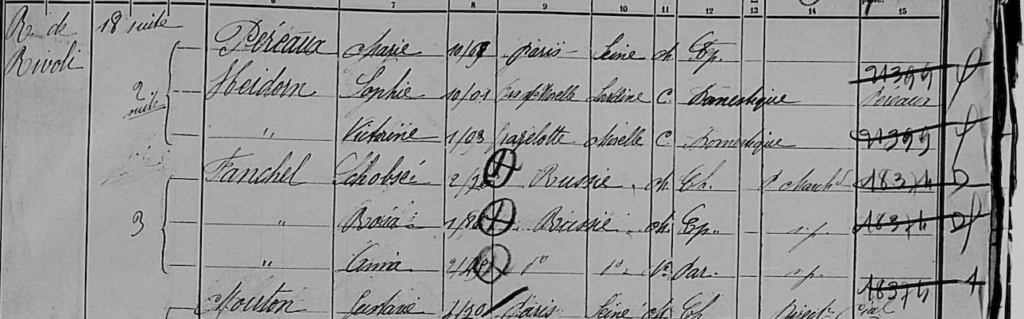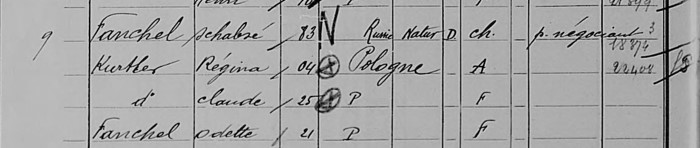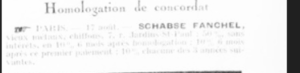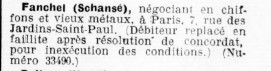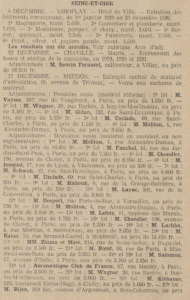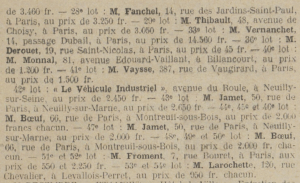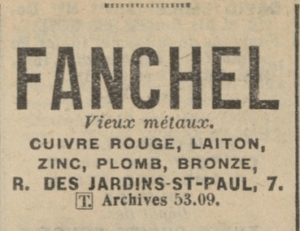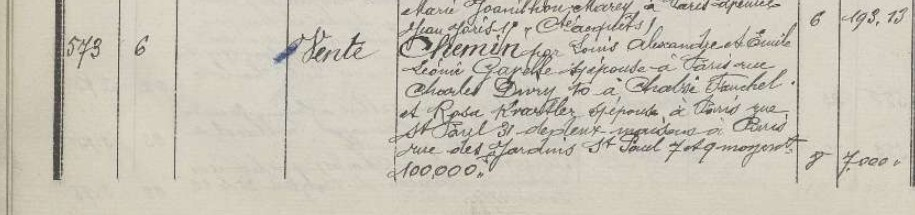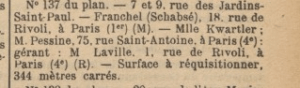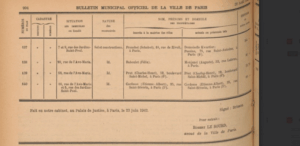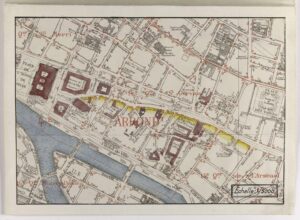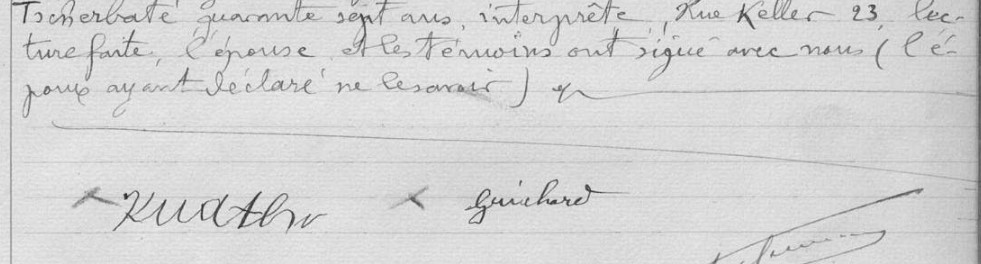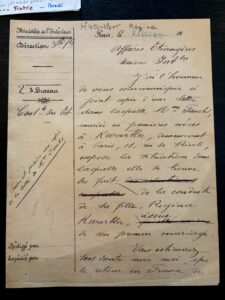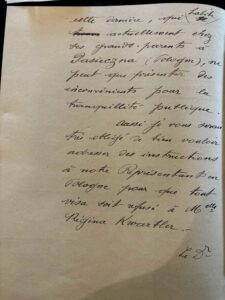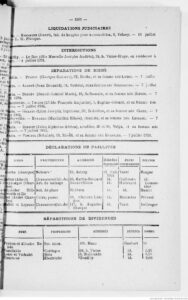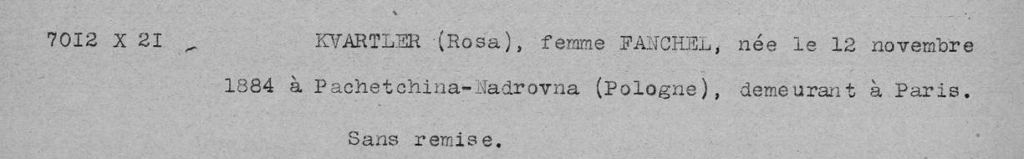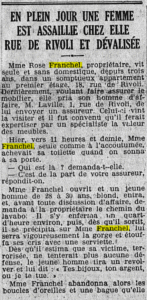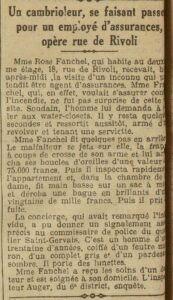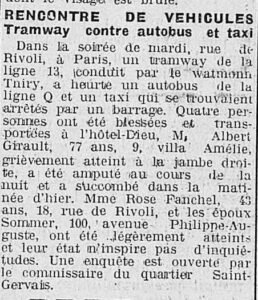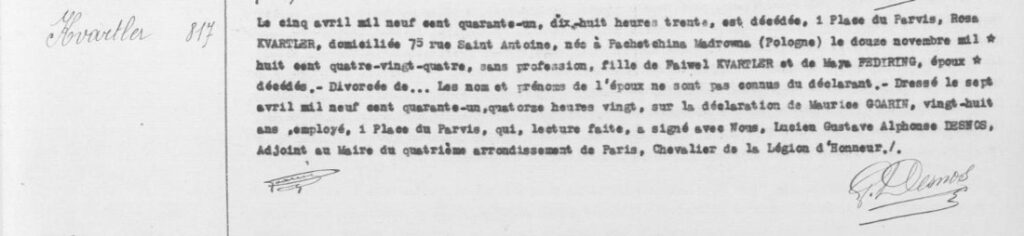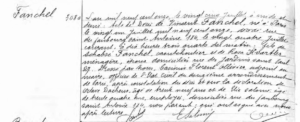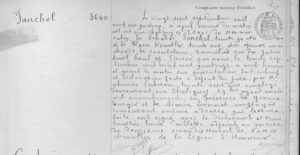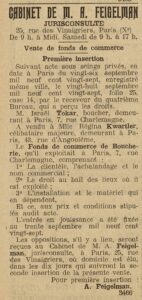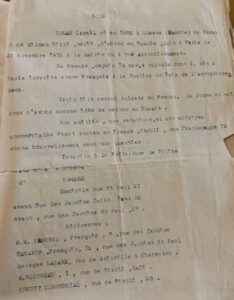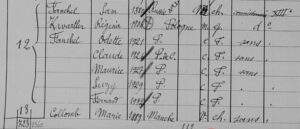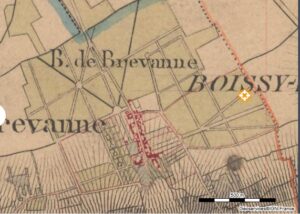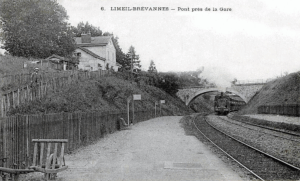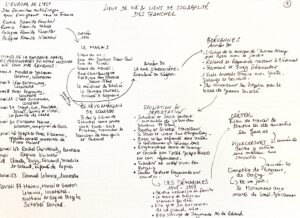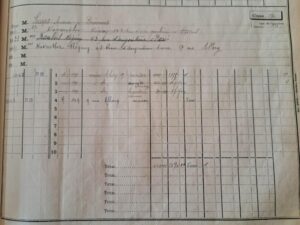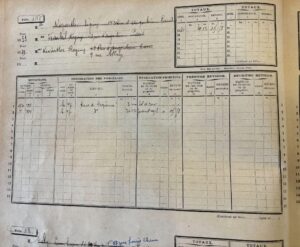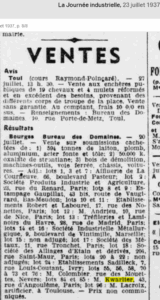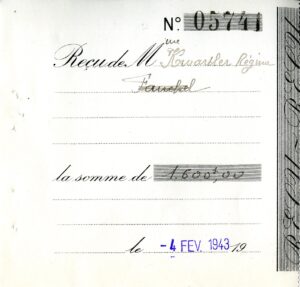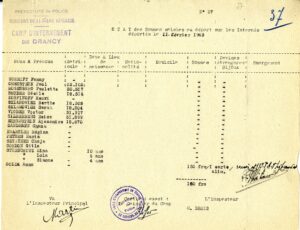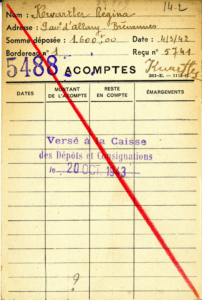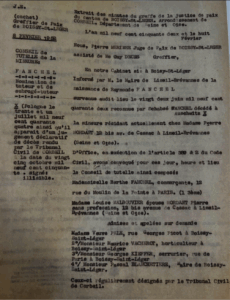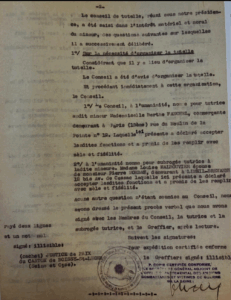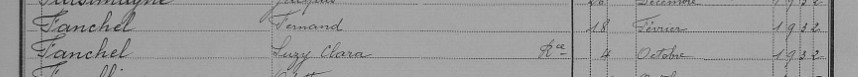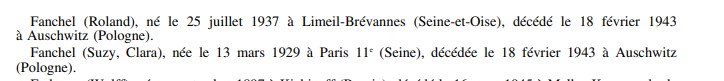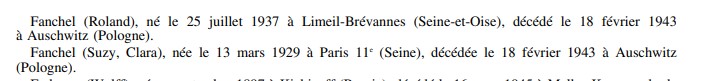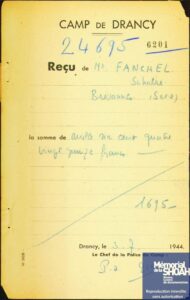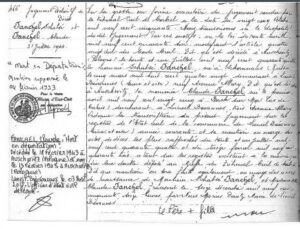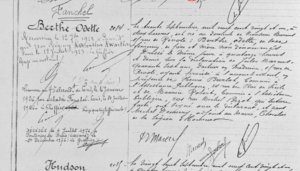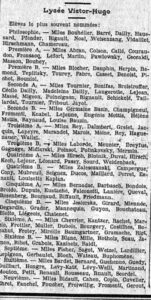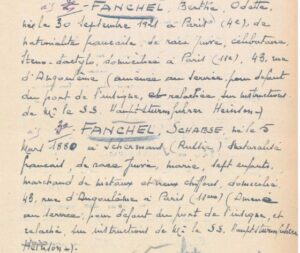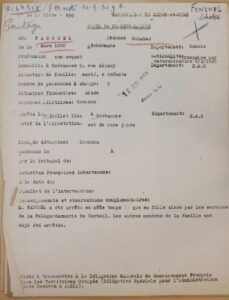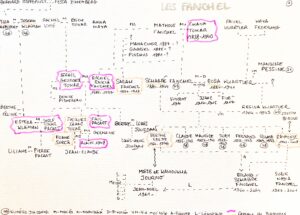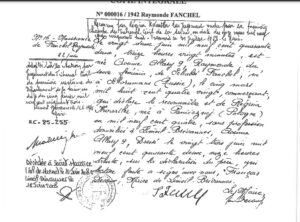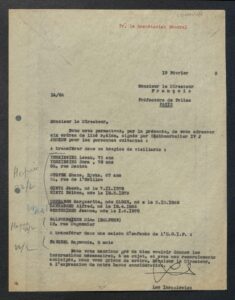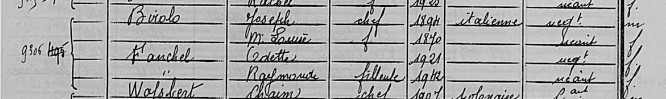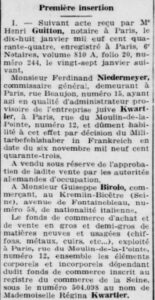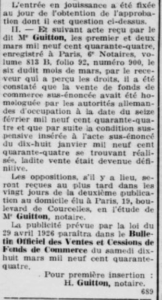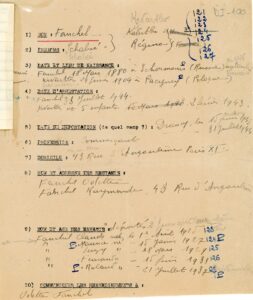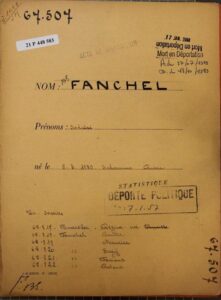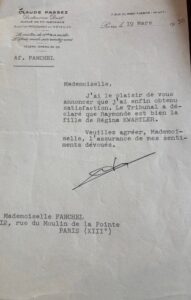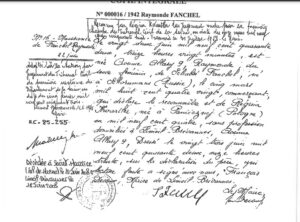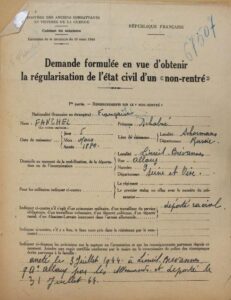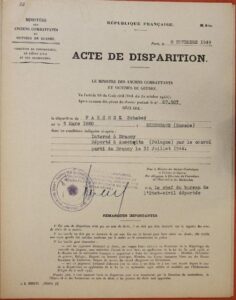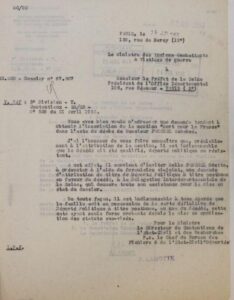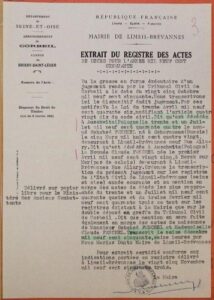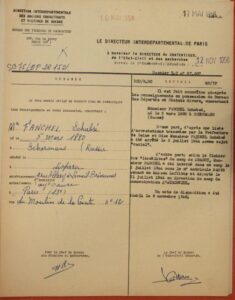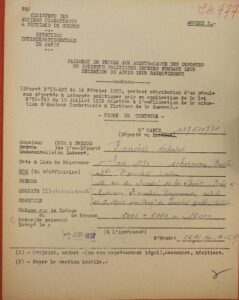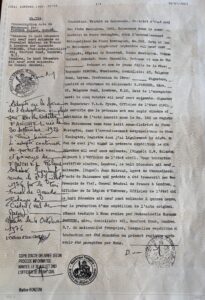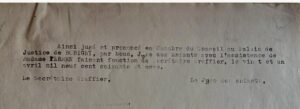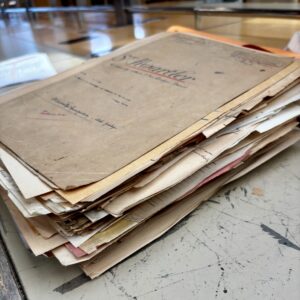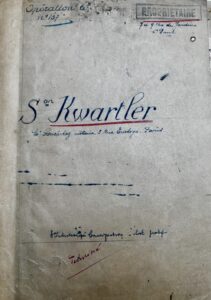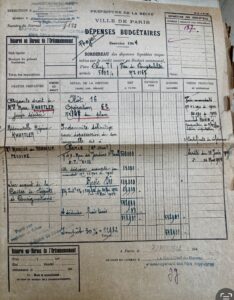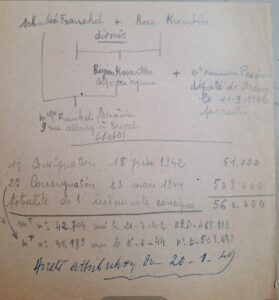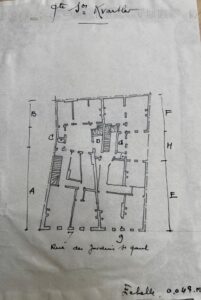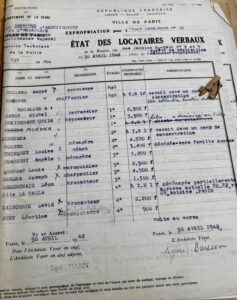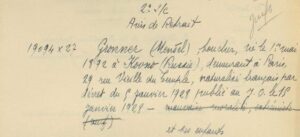Schabse FANCHEL
Schabsé Fanchel et les siens, 1880-1944, Convoi 77
Schabsé source : P. Deweerdt
Cette deuxième version de l’histoire des Fanchel a été motivée par plusieurs éléments. Tout d’abord, le dossier déposé à la CIVS en février 2025 est en cours d’instruction ce qui a demandé de nouvelles recherches ainsi que des précisions à apporter à la commission. Ensuite, ces recherches se sont traduites par des rencontres qui ont fait avancer la connaissance que l’on pouvait avoir de la famille Fanchel. Enfin la découverte d’un carton d’archives particulièrement pertinent a éclairé leur histoire.
Voici donc une version largement corrigée de la biographie de Schabsé.
A la fin de l’hiver 2004, il y a 21 ans, Ida Grinspan était venue témoigner auprès des classes de 3e, à ma demande. J’étais alors un très jeune professeur d’histoire dans un collège de banlieue.
A cette occasion, Ida avait parlé avec un de mes élèves, Andersen Nshimiye, “mineur” isolé Tutsi âgé de 19 ans, qui avait perdu son père, tué au Rwanda, et dont la famille avait été dispersée.
Ils avaient parlé longuement, deux rescapés de génocides du monde contemporain.
Depuis plusieurs années, passionnée de micro-histoire, j’ai mené avec mes classes, longtemps en binôme avec ma collègue Aurélie Trinkwell, des projets reposant sur l’histoire locale : dans un premier temps sur la Première Guerre mondiale à l’occasion de son centenaire avec par exemple l’histoire du dernier poilu brévannais ou du lien entre mémoire familiale et guerre. Ensuite, sur les faits de résistance dans la commune, Brévannes et l’hôpital Emile Roux ayant rassemblé de nombreux résistants, communistes, dont les rues de la ville portent aujourd’hui les noms : Pierre et Angèle le Hen, Jean-Marie-Prugnot, Marie le Naourès, Marius Dantz et tant d’autres… En s’intéressant à l’hôpital Emile Roux, mon mari et moi avons rassemblé une base de données sur les déportés brévannais. Plus récemment, nous avons travaillé sur le Convoi 77, et la famille Fanchel, pour laquelle il a effectué un énorme travail de recherche dans les différents fonds d’archives en France et à l’étranger. Le travail mené sur la famille Fanchel a été l’occasion de faire exploiter des données et faire rechercher des points précis par une intelligence artificielle dotée d’une fonction de deep research[1], mais aussi de critiquer et croiser les résultats obtenus avec les sources dont nous disposions. Force est de constater que cela a ouvert de nouvelles pistes de travail et éclairé certains points de l’histoire des Fanchel, notamment leur parcours migratoire, avec l’accès aux archives ukrainiennes mais nous en parlerons par la suite.
Entre octobre 2024 et mai 2025, la classe de 4eC a travaillé sur la biographie de Schabsé Fanchel, père de famille déporté par le convoi 77, ce convoi qui a causé la mort du père d’Ida Grinspan. J’ai voulu partager avec cette classe un travail de recherche de plusieurs années pour qu’ils acquièrent une méthodologie de la recherche aux archives, la démarche de l’historien et qu’ils s’approprient l’histoire de leur territoire en citoyens éclairés, afin de la replacer dans le contexte des migrations à l’échelle de la planète.
D’une certaine façon, il s’agit aussi de rendre leur histoire à la famille Fanchel dont plus aucun membre ne subsiste. C’est ce que Claire Podetti a appelé une “restitution inversée”.
La problématique qui a été donnée aux élèves dans le cadre du projet a été la suivante :
Comment les migrations passées et présentes et les trajectoires individuelles peuvent-elles être des clés de lecture de notre territoire ?
En 2019, les archives du Convoi 77 m’ont transmis 3 noms : Nathan Potzeha, Regina Potzeha et Schabsé Fanchel.
Nathan et Regina[2] sont inscrits sur le monument aux morts de la commune avec la mention morts en déportation à Auschwitz, pour que le souvenir de ces crimes soit à jamais voué à l’exécration des générations futures.
Source : Geneanet
Mais pas Schabsé.
Son histoire, ainsi que celle de sa famille, témoignent des parcours migratoires de nombreuses familles ashkénazes d’Europe de l’Est chassées par l’antisémitisme.
Schabsé, le parcours d’un immigré fuyant l’antisémitisme
Schabsé FANCHEL (le père), est né le 05/03/1880 à Schornmans (ou Schorniansk) en Bessarabie, actuelle Ukraine.
Il est le fils de Mathous, ou Mottez, ou Mollé Fanchel et de Hona, ou Chana ou Anna Tokar[3], venue en France avec lui. Elle vit 27, rue des Jardins Saint-Paul à Paris en 1936[4].
Source : recensement de 1936, archives municipales de la ville de Paris
Après son décès, à Brévannes, où elle va finir ses jours, avenue Allary, Hona, Anna ou Chana, est inhumée au cimetière de Bagneux à la fin de l’été 1940.
Source : archives municipales de la ville de Paris
Malak, Salimata, Malha
La personne dont l’archive parle est Chana Tokar. L’archive déclare son décès. Elle nous apprend que Chana est née en Russie et décédée en août 1940. Elle est la mère de Schabsé.
Le rêve américain de Schabsé
Avant de s’installer définitivement en France, Schabsé part aux Etats-Unis avec son frère Gabriel. Ils embarquent à Hambourg sur le Batavia, et ils arrivent à Ellis Island le 31 décembre 1906[5]. Le manifeste nous apprend que Schabsé mesurait 1,77 mètres et avait les cheveux noirs et les yeux gris. On pense que Schabsé n’a pas pour objectif de s’installer définitivement aux Etats-Unis car son lieu de destination est New York, alors que celui de Gabriel est la ville de Glendale en Pennsylvanie. Schabsé cite comme référence Seindel Jeldmann et Gabriel cite Simael Teldmann, ce qui est assez ressemblant. L’état du manifeste est assez mauvais et difficile à lire.
Gabriel, son frère cadet, né vers 1885, mesure 1,70 m. Il est décrit comme blond aux yeux bleus, avec un visage marqué par la petite vérole. On ne sait pas encore ce qu’il est advenu de lui.
Schabsé se fixe dans le Marais où il va exercer diverses professions : caoutchoutier, marchand de tissus et de vieux métaux, commissionnaire… Il voyage de nouveau aux Etats-Unis en 1912, il a alors 32 ans, embarque à Cherbourg le 24 juillet sur le Kronprinzessin Cecilie qui arrive à destination le 30 juillet à Ellis Island. Ce manifeste nous confirme que Schabsé ne sait ni lire ni écrire. Il déclare se rendre chez un ami, monsieur Timberg, 48, Lenox avenue à NYC. Sa dernière visite à New York remonte à 1908.
En recherchant les frères de Schabsé dans les listes de voyageurs conservées aux Archives Nationales de Washington, on a d’ailleurs trouvé qu’en 1962, la première fille de Schabsé, Berthe Odette, fait elle aussi un voyage aux Etats-Unis.
Pinshus H, un des quatre frères de Schabsé, peintre, est parti de Brème sur le Rhin le 30 Juillet 1903, à destination de Baltimore, il a déclaré être marié et se rendre chez son beau-frère (monsieur Cohen) à Saint-Louis[6]. Il a alors 32 ans.
Retour en France et installation dans le Marais
Schabsé a un premier enfant, Vincent en 1911 et il se marie en 1913 avec Rosa Kvartler ou Kwartler, polonaise née en Autriche, née le 12/11/1884.
Source : archives municipales de la ville de Paris, 1913.
Ils parlaient yiddish, en témoigne la présence d’un interprète à leur mariage.
Schabsé tente de s’engager pour la France durant la Première Guerre mondiale. Dépendant du 3e bureau de recrutement de Paris, il se présente en août 1914 mais est réformé. Cette information est mentionnée dans son dossier de naturalisation.
Source : Gallica
Selon Esther BENBASSA[7] dans son Histoire des juifs de France, Paris, Seuil (coll. « Points. Histoire »), 1997, p. 251, citée par Anaëlle Riou ; au sein du convoi 77, 7 hommes de confession juive et de nationalité étrangère se sont engagés volontairement dans l’Armée française ou la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale : Barouch Alazraki, Sol Ange, Sigismond Bloch, Joseph Brodsky, Nissim Cambi, Schabsé Fanchel et Maurice Marian.
L’article de Philippe-Efraïm Landau sur Les Juifs russes à Paris pendant la Grande Guerre, cibles de l’antisémitisme dans la revue Archives juives de 2001 apporte quelques pistes : “La méfiance, voire l’hostilité latente à l’égard des 30 000 immigrés juifs de l’Empire russe résidant à Paris ne date certes pas du conflit. Elle s’exprime dès la décennie précédente au cours de laquelle ils sont massivement arrivés dans la capitale. Comme les autres étrangers, une simple inscription à la Préfecture de Police ou à la mairie, conformément au décret du 2 octobre 1888, leur permet de résider sur le sol français, d’y trouver un emploi et de s’intégrer. […]
Les Juifs russes, qui ont fui les mesures et les violences antisémites de l’Empire tsariste, se répartissent distinctement dans Paris. Plus de 60% des immigrés se retrouvent dans la petite industrie de la confection – dont la casquette, le vêtement et la fourrure – concentrée principalement dans le Marais et, dans une moindre mesure, à Montmartre.[…] Une fois les nationaux mobilisés, les étrangers peuvent souscrire à un engagement volontaire pour la durée de la guerre en vertu du décret du 3 août. À partir du 24 août, plusieurs milliers de Juifs s’inscrivent, soit environ 8 500 sur un total de 31 000 enrôlements d’étrangers. Le premier jour, sur 1 560 demandes, environ 900 sont faites par des Juifs russes. Dans la capitale, vingt-sept comités d’enrôlement s’adressant à chaque minorité sont créés. Sur les quatre comités russes, deux sont organisés par des Juifs. En plein quartier Saint-Gervais Amédée Rothstein, Jacques Schapiro et Haïm Cherschevski fondent celui de la rue de Jarente qui recueille près de 3 000 adhésions dont 2 000 effectuées par les Russes.
Cet autre article de Philippe-Efraïm Landau intitulé, Frères d’armes et de destin. Les volontaires juifs et arméniens dans la Légion étrangère (1914-1918), dans la revue Archives juives de 2015, apporte des précisions sur le sort des volontaires juifs russes : C’est donc en vertu des promesses émancipatrices de la guerre et de leur profond respect pour la grandeur française que ces immigrés, méprisés et massacrés dans leurs pays d’origine, se mobilisent et sont prêts à se sacrifier pour une nation qui avait su les traiter, selon Yéchiel Kogan, « comme ses propres fils ». Défilant sur la place de la Bastille et acclamés aux cris de « Vivent les Russes ! Vivent les Juifs » par les Parisiens, plusieurs centaines d’individus distribuent des affichettes en yiddish et en français où la foule enthousiaste peut lire : « Frères ! C’est le moment de payer notre tribut de reconnaissance au pays où nous avons trouvé l’affranchissement moral et le bien-être matériel. » […]
Il séjourne au grand Hôtel de Bagnoles et Tessé-la-Madeleine en 1923 avec sa femme, ce qui montre qu’il a une bonne situation financière :
Source : archives municipales de la ville de Paris.
Schabsé devient français
Schabsé est naturalisé français en 1925, après une première demande rejetée en 1922.
Source : archives municipales de la ville de Paris,1925.
Edison : Fanchel Schabsé, marchand de chiffons, né le 5 mars 1880 à Schornmans Russie, demeurant à Paris. Il est naturalisé.
Son dossier de demande de naturalisation nous apporte de nombreux renseignements : Schabsé et sa femme déposent deux demandes simultanément. La première demande, de fin 1921 est rejetée au motif qu’il n’a “aucune utilité pour notre pays”.
Source : Archives Nationales
Le second dossier, daté de fin 1924, nous apprend que Schabsé tient absolument à rester en France.
Source : Archives Nationales
Il a prospéré économiquement, car il s’est acquitté du droit de sceau le plus élevé, soit deux fois 1201 francs, ses renseignements de moralité et d’opinion politique sont satisfaisants. Ci-dessous, la partie financière des deux dossiers de naturalisation, qui montre son enrichissement.
Source : Archives Nationales.
Il obtient alors une réponse favorable.
Pour ses affaires, il bénéficie de l’aide d’un conseiller juridique qui rédige ses documents.
Après sa naturalisation, il n’effectue pas son service militaire en France car il a été déclaré inapte lorsqu’il s’est volontairement engagé dans la Légion étrangère au début de la Première Guerre mondiale. Réformé en 1914, il a cependant effectué 7 années de service militaire en Russie.
On trouve également la mention de sa sœur Rachel ou Rukla Tokar, domiciliée 31, rue Saint-Paul, dont nous reparlerons plus tard. Son autre sœur Sarah est décédée depuis 1913. On apprend aussi qu’il a quatre frères à l’étranger, dont Manacher, boucher à New York qui aurait combattu auprès des Etats-Unis durant la Première Guerre mondiale. Manacher ou Menasches serait né vers 1887 et a embarqué le 22 Juin 1907 à bord du navire Batavia parti d’Hambourg pour Ellis Island. Le manifeste indique qu’il est tailleur et mesure 1,70 m. Il est indiqué qu’il se rend à New York rejoindre son frère Schabsé, ce qui confirme le séjour de ce dernier. Nous vous avons déjà présenté Gabriel et Pinshus.
Un notable
En 1926, Schabsé vit 7, rue des Jardins Saint-Paul à Paris, comme l’atteste son bon de commande pour un caveau de 18 places au cimetière de Bagneux[8]. Il est propriétaire de l’immeuble, comme nous l’apprend son dossier de naturalisation et le sommier foncier que nous avons consulté.
Source : Archives personnelles de monsieur Journo, avec son aimable autorisation.
Cette commande est vraisemblablement un caveau destiné à être une œuvre caritative. En effet, aucun membre de sa famille n’y est enterré. La mention “caveau Fanchel” apparaît en haut de la tombe, les personnes enterrées sont décédées entre 1924 et 1926[9].
La famille Fanchel a cinq autres concessions dans la section 3 du cimetière de Bagneux.
Source : M-A Deweerdt
Une vie maritale complexe
Avec Rosa, sa femme, il occupe plusieurs domiciles, dont certains : 27, rue des Jardins Saint-Paul, où vivent également Rachel Fanchel et Hana Tokar, puis 18, Rue de Rivoli à Paris, un appartement au loyer onéreux.
Il est inscrit sur les listes électorales en 1932 ce qui montre qu’il est électeur, mais il est alors domicilié 43, rue d’Angoulême.
Source : archives municipales de la ville de Paris.
Malgré leur situation aisée, Schabsé et Rosa ont plusieurs enfants qui ne survivent pas : Vincent, Isaac, ainsi qu’une petite fille morte née et non nommée.
Le dossier de naturalisation de Schabsé nous apprend que sa femme, Rosa, a eu une fille en 1904, Reginy ou Regina, de père inconnu.
Regina vient passer les fêtes de fin d’années 1920-1921 à Paris et Schabsé en tombe amoureux. De cette liaison naît Berthe Odette, le 30 septembre 1921 à Paris 4e, alors que Régina a 17 ans. Regina Kwartler a pour ce motif fait l’objet d’un dossier à la sécurité intérieure, en 1922, qui fait partie des fonds de Moscou. On y trouve un courrier de sa mère Rosa :
Manifestement le courrier de Rosa reste sans effet car Schabsé aura entre 1925 et 1942 six autres enfants avec Regina : Claude, Suzy Clara, Maurice, Fernand, Roland et la petite Raymonde.
Certains naissent à Paris, d’autres à Brévannes, témoignant des différents lieux de vie de la famille.
Ismaila et Mohamed
Cette archive date de 1922, elle parle des rapports entre une mère et sa fille et de menaces répétitives. Elle demande que des mesures soient prises et que Regina ne puisse pas avoir de visa. Cela nous apprend que les parents doivent respecter leurs enfants et inversement.
Jo-Yie, Jaya, Gabriel
Dans cette archive, Rosa parle de sa fille, Regina. Rosa veut empêcher sa fille de rentrer en France pour éviter un malheur. Sa fille a en effet eu un enfant, Berthe, avec Schabsé . Cela a motivé une démarche au commissariat de police de Paris. Cette archive nous apprend que les sept enfants de Schabsé ne sont pas à Rosa mais à Regina.
Lina et Maïssane
Cette archive explique que Régina se trouve actuellement en Pologne, et qu’il ne faut pas qu’elle revienne en France, car elle présente des inconvénients pour la tranquillité publique. À cause de sa conduite, il faudrait lui refuser un visa.
Cela éclaire les relations entre Rosa et Regina, et la séparation des biens entre Schabsé et Regina, puis leur divorce en 1929. Voici le jugement par défaut de la séparation de biens, établi en faveur de Rosa :
Source: P. Deweerdt
Comme dit précédemment, Schabsé et Rosa vivaient avec la mère de Schabsé, Onna ou Hona[10], rue de Rivoli :
Source : recensement de 1926, archives municipales de la ville de Paris.
Schabsé est également recensé au 43, rue d’Angoulème la même année MAIS avec Regina, sa compagne, fille de Rosa, et leurs deux premiers enfants.
Source : recensement de 1926, archives municipales de la ville de Paris.
Schabsé divorce en 1929 de Rosa, et poursuit sa vie commune déjà entamée avec Régina.
Les revers de fortune de Schabsé
Schabsé rencontre des difficultés financières après son divorce de Rosa : en témoignent ses deux faillites et son homologation de concordat.
Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica, 1927
Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica, 1927.
Transcription : Paris le 17/08 : Schabsé Fanchel, vieux métaux, chiffons, 7, rue des Jardins Saint-Paul, 50% sans intérêts, 10% six mois après homologation, 10% 6 mois après ce premier paiement, 10% chacune des 3 années suivantes.
Faillite de 1929 (25/10/29)
Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica.
Jaya
Cette archive de 1929 traite de la faillite de l’entreprise de S. Fanchel. Cette archive nous apprend que lorsque des entreprises font faillite, il est possible de solder les dettes. Il était négociant en chiffons et vieux métaux, rue des jardins Saint-Paul à Paris (archive BNF).
En janvier 1929, il achète deux lots au 14, rue des jardins Saint-Paul :
Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica
Ici en 1928, on le trouve dans l’annuaire du commerce (Bottin Didot).
Source : archives de la ville de Paris.
La réquisition et l’expropriation
Son commerce et ses logements des 7 et 9, rue des Jardins Saint-Paul, sont réquisitionnés puis lui et Regina en sont expropriés, ce qui constitue une spoliation. Ils étaient propriétaires de ce lieu, mais on ne sait pas s’ils ont reçu un dédommagement.
Source : Archives de Paris
Elias, Amayas et Adam
Cette archive date de 1919. Dans cette archive, on apprend l’achat de deux bâtiments pour la somme de 100 000 francs.
Cette adresse appartenant à l’îlot 16, elle est réquisitionnée puis Schabsé et Regina sont expropriés. On pense qu’ensuite la famille est partie à Brévannes, comme l’explique Isabelle Backouche dans Paris transformé le Marais 1900-1980 Créaphis Éditions. Elle décrit l’aménagement de l’îlot 16 comme une somme de politiques publiques entre hygiénisme et stigmatisation des familles juives.
Réquisition de 1942
Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica
Expropriation de 1943[11]
Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica
Kylian : Archive d’expropriation de Schabsé et Régina des 7 et 9, rue des Jardins Saint Paul, on y indique deux autres domiciles : 18, rue de Rivoli pour Schabsé et 75, rue Saint Antoine pour Regina. Elle date de juin 1942, elle vient de la BNF.
Source : Isabelle Backouche
Schabsé et Rosa : un mariage qui ne va pas durer
Rosa Kvartler, 1884-1940, épouse de Schabsé de 1913 à 1929
Rosa Kvarlter (Kwartler), épouse Fanchel, fille de Faïvel Kvartler et Haya ou Maya Fredering ; est née le 12/11/1884 à Pachetchna Nadrovna (Pacziejna) en Autriche de parents polonais.
Quand elle épouse Schabsé, le 25 mars 1913 à 9H50 à la mairie du 4e arrondissement de Paris, elle vit 27, rue des Jardins Saint Paul, et n’a pas de profession (ménagère). Elle est dispensée du consentement de ses parents par une note du procureur.
Les témoins du mariage sont Emile Guichard, 52 ans, garçon de salle ; Isidore Golstein, 28 ans, mécanicien ; Pierre Xavier, 72 ans, tapissier, Haïm Tcherbaté, 47 ans, interprète. Schabsé ne savait pas écrire et sa femme assez pour signer en bas de son acte de mariage.
Source : Source : archives municipales de la ville de Paris.
Rosa, très en colère contre Schabsé et ses écarts de conduite avec sa fille, écrit un courrier à la préfecture de police pour que Régina n’aie pas l’autorisation de revenir de Pologne, ce qui n’aboutit pas et elle engage pour défendre ses intérêts un très célèbre avocat, maître Jean-Louis Thàon.
Le directeur de la Sûreté nationale appuie la demande de Rosa et de son avocat.
Source : Archives Nationales
Rosa et Schabsé signent un contrat de séparation de biens en 1924, après les difficultés conjugales que l’on connaît. Rosa est alors assistée d’un avoué ainsi que d’un notaire, alors que Schabsé ne se présente pas aux audiences.
Source : archives municipales de la ville de Paris.
Rosa est également naturalisée le 06 février 1925, les femmes étant à cette époque associées à la demande de leur époux.
Source : archives municipales de la ville de Paris.
Elle semble par la suite avoir une vie aisée, comme l’atteste ce faits-divers relaté dans le journal l’Oeuvre du 6 janvier 1928 où elle se fait dérober ses boucles d’oreilles et une bague d’une grande valeur par un faux représentant. Elle a par ailleurs un domestique que l’on trouve mentionné dans les recensements.
Rosa va vivre rue de Rivoli durant encore plusieurs années. Le loyer y est onéreux (8000 francs). Les travaux récents d’Isabelle Backouche, Sarah Gensburger et Éric Le Bourhis sur la spoliation des biens mobiliers sont, à ce titre, intéressants, car nous n’avons pas d’informations concernant ce que pouvaient représenter les biens matériels des Fanchel. Isabelle Backouche, qui a répondu à ma demande, n’a pas étudié les adresses des domiciles de la famille dans son ouvrage.
Source : Gallica.
Source : Gallica.
Dans Paris Midi, le 6 Janvier 1928, elle revient sur cette agression et également sur ses difficultés conjugales de façon assez burlesque. L’article évoque en effet le sort des femmes seules, et décrit Rosa comme une “petite dame ronde et très forte”, qui expose sa situation familiale et explique que ses revenus ne sont pas si importants parallèlement au vol de bijoux de grande valeur qu’elle a subi.
Source : Gallica.
En novembre 1928, elle est victime d’un accident de la route relaté dans Le Petit Champenois : journal républicain quotidien :
Source : Gallica.
Elle divorce le 15 avril 1929 de Schabsé.
Elle décède à l’Hôtel Dieu le 05 avril 1941 et est inhumée à Bagneux, seule.[12]
Source : Archives Municipales de la ville de Paris
Source : M-A Deweerdt
Vincent et Isaac, ses fils décédés, sa fille décédée non nommée
Schabsé et Rosa auront trois enfants, dont aucun ne survivra.
Vincent Fanchel 21/07/1911- 24/07/1911[13]
On ne sait pas où Vincent a été inhumé, il n’y pas de traces de lui.
Source : archives municipales de la ville de Paris.
Isaac Fanchel 27/09/1914- 6/06/1915
Source : archives municipales de la ville de Paris.
Isaac repose à Bagneux où il est inhumé en 1926 lorsque son père fait faire un caveau familial.
Source : P. Deweerdt
Source : Archives personnelles de monsieur Journo, avec son aimable autorisation.
Enfant mort né en 1917 : Leur fille, morte née en 1917 n’a pas de prénom. Elle a été inhumée à Bagneux, 102-8-14, lorsque que nous nous sommes rendus sur place, le conservateur nous a expliqué que sa tombe avait été une concession temporaire de 5 ans et qu’on ne pouvait pas savoir ce qu’il était advenu de ses restes.
La vie de Schabsé et Régina
Régina Kwartler, déportée par le convoi 47 en date du 11 février 1943
Regina ou Reginy est née en février 1904 à Pasieczna en Pologne.
A cause de leur homonymie, on a longtemps confondu Rosa et Regina. Elles sont bien deux personnes distinctes : mère et fille.
Source : P. Deweerdt
Son dossier est conservé à Caen au Service historique de la Défense, Cote AC 21 P 471 025[14]. Regina est née de père inconnu, elle vit habituellement en Pologne avec ses grands-parents, les parents de Rosa. Après la naissance de Berthe-Odette, elle retourne en Pologne quelque temps, mais malgré les démarches de sa mère, elle revient vivre avec Schabsé.
On sait peu de choses de Regina, si ce n’est qu’elle participe activement aux affaires familiales. Par exemple, en 1927, elle rachète une boucherie à la famille Tokar :
Source : archives municipales de la ville de Paris.
On retrouve souvent le nom des Tokar associé à celui des Fanchel : on est presque certains que le lien est le mariage d’Israël Tokar et Rachel Fanchel, sœur ou demi-sœur de Schabsé.
Les Fanchel et les Tokar qui n’ont pas été déportés sont inhumés à Bagneux dans deux sépultures dos à dos. Durant l’enquête, j’ai eu l’occasion de rencontrer un petit-fils d’Israël Georges Tokar et sa femme, Pierre et Liliane.
Source : Archives Nationales, fonds de Moscou
Diego et Devan
Cette archive fait partie de la demande de naturalisation de la famille Tokar. Elle nous apprend qui cite comme référence son beau-frère François. Cela nous apprend que la femme d’Israël pourrait bien être la sœur de Francois (Schabsé). Cela prouve donc le lien de parenté entre les deux familles.
Regina est recensée rue d’Angoulême en 1931 et 1936, avec les enfants eus avec Schabsé :
Source : archives municipales de la ville de Paris.
Régina possédait également une maison à Brévannes, 9, avenue Allary ainsi qu’un terrain non bâti.
Source : IGN remonter le temps.
Il était alors facile et rapide de rejoindre la campagne depuis le chemin de fer de la Bastille.
Source : Archives de la mairie de Limeil-Brévannes.
A Limeil-Brévannes, la famille Fanchel retrouve d’autres familles parlant la même langue. Si l’on observe le recensement de 1936, on voit que les Polonais représentent la communauté étrangère la plus importante dans la commune, comme le relève monsieur Lassalle[15] :
Dans le recensement du 6 juin 1936, la commune compte 5865 habitants ; dont 1090 au sanatorium et 908 à l’Hospice.
Nationalité déclarée :
- Allemande 2
- Américaine 1
- Belge 17 dont 2 enfants
- Espagnole 2
- Hollandaise 2
- Italienne 52 dont 20 enfants
- Polonaise 112 dont 47 enfants
- Portugaise 2
- Russe 4
- Serbe 1
- Suisse 17 dont 2 enfants
- Tchèque 20 dont 2 enfants
Une des premières hypothèses de mon travail était d’essayer de prouver que ces familles qui parlaient le yiddish et partageaient une religion commune avaient pu avoir des liens de sociabilité. Guy Lassalle a mené l’enquête, et en observant très attentivement, les recensements entre les deux guerres mondiales sur la commune, il a relevé certaines choses :
“Au 5, rue de Boissy, en 1921, on trouve monsieur Laurent Dufossé. Sa femme est Jeanne Geninet épouse Dufossé, elle est dactylo et employée par les Fanchel. A l’époque où Jeanne épouse Laurent, en 1919, elle est employée de commerce et est domiciliée… 13, rue de Boissy ce qui est l’adresse de Nathan et Regina Potzeha”. On la retrouve ensuite à d’autres adresses à Brévannes, elle sera notamment employée à l’hôpital Emile Roux. Selon Monsieur Lassalle « L’hospice de Limeil ayant un grand service de sanatorium, avait des difficultés pour embaucher des infirmières (peur de la maladie). A partir de 1920, il y avait 450/500 morts par an. Dès 1932, l’hospice avait son école pour les infirmières. Des familles venaient de province (Bretagne, Auvergne, etc) pour combler tous les postes ».
On peut donc être presque certains que les familles Fanchel et famille Potzeha se sont connues et fréquentées.
Laurent va trouver la mort pendant la guerre, son nom est d’ailleurs inscrit sur le monument aux morts. C’est un parent (un oncle) de Josette Soubriez née Dufossé qui a témoigné et que nous vous présenterons plus tard.
Sur ce document, on voit parfaitement l’emplacement de la maison des Fanchel :
La consultation des matrices du cadastre napoléonien pour les propriétés bâties et non bâties, aux archives départementales du Val-de-Marne, nous renseigne sur l’attachement des Fanchel à la commune de Brévannes.
Regina acquiert en 1930 la maison du 9, avenue Allary comme en témoigne ce document :
Source : matrice cadastrale, AD 94
Par ailleurs, elle possède également 39 ares du Parc de Brévannes, folio 1187, achetés en 1930, dont on ne sait pas ce qu’ils sont devenus après la Guerre, le cadastre ne mentionnant pas d’autre propriétaire. Cette parcelle se trouve aujourd’hui dans le quartier de l’école Picasso.
Source : matrice cadastrale, AD 94
On peut penser que Regina et les enfants s’installent à Brévannes définitivement à partir de 1935 : tout d’abord parce que c’est l’adresse qui apparaît sur le cadastre, ensuite car ses deux derniers enfants, Roland et Raymonde, y naissent.
On remarque que le cadastre mentionne aussi les propriétaires du 11, avenue Allary qui possèdent aussi la maison du 3, avenue Allary, dernier domicile de Chana Tokar. Le 11 avenue Allary abritait en effet une fabrique de paillassons avec des métiers à tisser ; pour couvrir les cultures dans les champs. Les paillassons étaient sulfatés pour éviter le pourrissement. Les ouvrières étaient en majorité polonaises. L’employeur était Monsieur Graff. Le 13 août 1941, il y a un grand incendie dans la fabrique En 1946, au recensement, les mêmes ouvrières sont indiquées au 11 avec la famille Graff. L’emplacement actuel est la Résidence du Clos de Boissy au 11-15 av. Allary.
Elle participe également à la vie du foyer en achetant des matériaux aux enchères selon La Journée industrielle, 23 juillet 1937.
Source : Gallica.
Mais début 1942, on constate une intensification et une radicalisation de la politique anti-juive en zone occupée : les rafles se multiplient.
Selon Claude Singer, Historien, Université de Paris I (DUEJ), dans Les grandes rafles de Juifs en France,
À partir de l’été 1942, ce sont désormais tous les Juifs de France, sans distinction de sexe, d’âge ou de nationalité, qui sont menacés. Et la menace est très sérieuse puisque les arrestations débouchent, dans la plupart des cas, sur des déportations vers une destination inconnue, hors du territoire national. L’opinion publique apparaît troublée par cette radicalisation et exprime aussi sa réprobation. Comment accepter en effet la succession de scènes d’horreur qui accompagnent les rafles, en particulier les cris et les pleurs des jeunes enfants lorsqu’ils sont arrachés à leurs parents ? […] En 1943 et 1944 arrestations, rafles et déportations se poursuivent, tant à Paris qu’en zone occupée ou en zone sud. Au total, de mars 1942 à août 1944, 75 000 Juifs sont déportés hors de France. La majorité sont des Juifs étrangers mais un tiers environ de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants sont des Juifs français. Il faut dire que les autorités allemandes ne faisaient aucune différence entre Juifs français et Juifs étrangers. Pour l’Allemagne nazie, tous les Juifs, sans distinction d’âge et de nationalité, étaient voués aux déportations et à l’extermination.
Elles concernent des citoyens étrangers comme Régina et français comme les enfants Fanchel. Les enfants vont à l’école Anatole France et portent l’étoile jaune, selon leurs camarades de classe, monsieur Bernard Berton, mesdames Solange Falière et Josette Soubriez, qui sont des connaissances de Guy Lassalle et de son épouse.
Regina est arrêtée le 02 février 1943 ( jour de la reddition de von Paulus à Stalingrad), à Brévannes, et internée à Drancy avec Claude, Maurice, Fernand, Suzy, Roland et la petite Raymonde, huit mois, puis déportée.
A son arrivée au camp de Drancy, le 03 février, elle a sur elle 1600 francs, ce qui est une somme conséquente.
Source : Archives de la Préfecture de police de Paris
Lors de sa déportation, il n’est pas fait mention d’argent saisi sur sa personne.
Source : Archives de la Préfecture de police de Paris
La somme qu’elle possède à son entrée au camp sera ensuite reversée à la Caisse des dépôts.
Source : Archives de la Préfecture de police de Paris
Voici le texte qui retrace son arrêt de mort : Extrait du Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld, édition de 1978. Notices des convois mises à jour par Jean-Pierre Stroweis.
L’interruption des transports dura pendant près de deux mois. Eichmann et la Sipo-SD de France firent en décembre le point de la situation et des perspectives de déportation pour le début 1943. Le 31 décembre, Knochen câble à Eichmann que la déportation reprendra à la mi-février, sans pouvoir préciser le nombre de Juifs touchés par cette mesure. Mais, dès le 21 janvier 1943, Knochen câble à nouveau à Eichmann. Il lui demande quelles sont les possibilités de transport pour 1 200 Juifs susceptibles d’être déportés. Il lui indique que 3 811 Juifs sont internés à Drancy, dont 2 159 Français. Il lui pose enfin la question : les Juifs français peuvent-ils être déportés ?
Le 25 janvier, Günther, l’adjoint de Eichmann, répond que le Ministère des Transports du Reich a donné le feu vert pour des possibilités de transport par wagons de marchandises pour 1 500 à 2 000 Juifs, de Drancy à Auschwitz. Contre la déportation des Juifs français, câble Günther, pas d’objection, si elle s’effectue en accord avec les lignes directrices de l’évacuation des Juifs de France. Il indique, en outre, que l’escorte de Drancy à la frontière du Reich sera désormais assurée par un kommando du SD de Metz et qu’à partir de la frontière, ce sera la police d’Ordre (Ordnungspolizei), qui se chargera d’escorter le convoi jusqu’à Auschwitz. Le 26 janvier, Knochen télexe à toutes les gestapos régionales : arrêtez tous les Juifs déportables et transférez-les à Drancy. […]
Le 3 février, Röthke, chef du service anti-juif de la Gestapo, télexe au RSHA à Berlin, au bureau d’Eichmann, que le 9 et le 11 février, 2 trains partiront pour Auschwitz, à 8 h 55, avec environ 1 000 Juifs. Le 5 février, Röthke télexe à l’Ordnungspolizei que 3 convois sont prévus et que des commandos d’escorte de 12 à 15 hommes doivent être fournis. Le même jour, Röthke demande à la Gestapo de Dijon de transférer les Juifs en leur pouvoir pour déportation les 9 et 11 février. Au lendemain du départ du convoi du 9 février, Röthke, chef du service anti-juif de la Gestapo, rédige une note détaillée, qui porte le paraphe de ses destinataires, Knochen, le chef des services de sécurité et de la police de sûreté, la Sipo-SD, et le général Oberg, chef des SS et de la police allemande en France [XXVc-204].
Dans son rapport, Röthke indique : 837 Juifs français sont internés à Drancy, à la suite des rafles de décembre 1941 et de 1942, plus 661 Juifs français ayant enfreint les lois. L’Office central de sécurité du Reich, le RSHA, a donné le feu vert pour de nouveaux transports de 1 000 Juifs aux dates du 9, du 11 et du 13 février 1943.[…] De même, le second convoi et à partir avec 1 000 Juifs apatrides ou appartenant à des nationalités déportables. Quant au troisième transport, le 13 février, il doit être constitué de Juifs français ayant commis des délits et internés à Drancy. En outre, la police française veut interner, jusqu’au 11 février, grâce à quelques petites rafles, des Juifs déportables, donc étrangers. La police française a fait elle-même cette demande parce qu’elle éviter surtout que des Juifs français soient déportés. Les représentants de la police française ont déclaré à Röthke que la question de la déportation des Juifs de nationalité française n’était pas encore réglée entre les gouvernements français et allemand. En conséquence, la police française n’aidera pas à la déportation des Juifs français, même ceux passibles d’une peine, tant que cette question ne sera pas réglée. Röthke conclut ainsi sa note : « J’ai répondu à ces messieurs que cette optique m’étonnait cependant, eu égard au fait qu’en 1942 nous avons déjà déporté des Juifs de nationalité française ayant contrevenu aux dispositions légales les concernant. Sauts (le collaborateur du préfet Leguay, représentant en zone occupée de Bousquet, secrétaire d’Etat à l’Intérieur de Vichy) a encore déclaré que, d’après le point de vue de Bousquet, nous pouvions déporter tous les Juifs français, qui se trouvent à Drancy, mais que la police française ne pourrait nous aider. Après décision au téléphone du BdS (Knochen), j’ai déclaré à Sauts que le transport du 13 février partirait de toutes façons. Je ferai encore ce soir un rapport au RSHA sur la question des transports ».
Après le renversement de situation produit par la défaite allemande à Stalingrad, Vichy devenait, on le voit, plus prudent dans sa collaboration anti-juive avec la police nazie. Sa réserve se manifestait au sujet de la déportation des Juifs français, qui pouvaient en cas de victoire des Alliés, lui être reprochée avec plus d’efficacité judiciaire et passionnelle que celle des familles de Juifs étrangers, ne laissant derrière elles que peu de traces dans la communauté nationale française. De là, les réticences de Vichy à afficher trop ouvertement des policiers français au départ de transports de Juifs français ; de là aussi son cynisme imbécile : organiser des rafles de Juifs étrangers pour éviter la déportation de Juifs français. Comme l’écrit Knochen dans son rapport télégraphique sur « la solution finale du problème juif en France », le 12 février, au chef de la Gestapo du Reich, Müller : pour préserver les Juifs français de la déportation, la police française a arrêté, le 11 février, et livré spontanément 1 300 Juifs étrangers, qui seront déportés, tout comme les Juifs français.
Le second convoi de février, celui du 11, a été constitué de Juifs étrangers, comme nous venons de le constater. Nous avons dénombré 372 Polonais, 154 Français (surtout des enfants nés en France de parents étrangers), 109 Russes, 65 Hollandais, 64 Roumains, 56 Allemands, 41 Turcs, 40 Grecs, 32 Hongrois, 20 Tchèques, 16 Autrichiens, 15 Belges, 10 Bulgares et quelques autres divers, dont même une Juive, née en Pologne et de nationalité chinoise par mariage. Nous avons compté 499 hommes, 477 femmes et 22 indéterminés. Il y a 175 enfants de moins de 18 ans, dont 123 de moins de 12 ans. 172 déportés ont plus de 60 ans (des vieillards furent pris dans des asiles et amenés le 10 février à Drancy en même temps que des enfants pour compléter l’effectif).
Le télex habituel adressé à Eichmann et à Auschwitz est daté du 12 et indique que la veille à 10 h 15 un transport a quitté la gare du Bourget/Drancy en direction d’Auschwitz avec 998 Juifs, avec comme chef d’escorte, l’Oberleutnant Kassel, de la Schutzpolizei, qui a rédigé, le 14 février un rapport au sujet de tentatives d’évasions, qui eurent lieu avant la frontière française La liste n°47 est en très mauvais état. De nombreux noms sont presque illisibles, en raison de l’effacement des caractères sur le papier pelure. 9 sous-listes :
- Romainville : il doit s’agir de Juifs étrangers ayant enfreint les règlements ou suspectés d’actes de résistance et transférés du fort de Romainville à Drancy.
- Romainville – Français : 16 personnes de nationalité française, dans le même cas que ci-dessus.
- Compiègne étrangers : 12 hommes transférés du camp de Compiègne à Drancy.
- Compiègne – Français : 39 hommes.
- Drancy – 1 : 56 personnes, dont plusieurs familles, comme Abraham et Mirla CHECINSKI âgés de 48 et 46 ans, et leurs quatre enfants, Wolf 16 ans, Simon 14 ans, Elly 11 ans et Anna 8 ans.
- Drancy – 2 : 745 noms, dont 79 barrés, soit 666 partants. De nombreuses familles, dont la plupart des enfants sont Français : Henri AJZENBERG 3 ans ; Maxime BORENHEIM 3 ans ; Jeannette et Hélène DIAMAND, âgées de 4 ans et 2 ans ; Samy GRIN 9 ans ; Joseph HABER 8 ans ; Tony JAKUBOVITCH 5 ans ; Hélène et Simone ZAWIDOWICZ, âgées de 8 et 6 ans ; Anna et Lucette KLEIN, âgées de 6 et 3 ans ; Michel ZELICKI 1 an ; Gilles LEWINGER 1 an ; Madeleine WAIS 1 an ; Claudine MALACH 3 ans ; Micheline MULLER 1 an ; Germaine et Pierre ROTH de 7 et 3 ans ; Jacqueline KRAVTCHIK 2 ans ; Elie et Colette SALOMON, 9 et 2 ans respectivement ; Myriam et Abel SLUIZER, âgés de 5 et 2 ans. Parmi les familles : Elie et Mathilde AZOUVI, âgés de 50 et 39 ans, et leurs trois enfants, Eva 17 ans, Louisette 14 ans et Gaston 12 ans ; Samuel et Gracia BERAHA, âgés de 46 et 37 ans, et leurs trois enfants, Albert
9 ans, Michèle 8 ans et Monique 4 ans ; Georges et Nesca ERDELYI, âgés de 34 et 31 ans, et leurs trois enfants, Betty 4 ans, Michèle 3 ans et Annie-Rose 2 ans ; Doudou ESKENAZI et ses quatre enfants, Rose 13 ans, Allegra 10 ans, Albert 7 ans et Leon 5 ans ; Perla GOLDSZTAJN, 30 ans avec Micheline 2 ans et Françoise 1 an ; Moise et Perla KAVAYERO âgés de 45 et 43 ans, et leurs cinq enfants, Sarah 19 ans, Esther 17 ans, Elie 14 ans, Diamante 10 ans et Suzanne 6 ans ; Laja KUPERBERG 35 et ses trois enfants, Fajga 13 ans, Esther 9 ans et Henri 1 an ; Djaya LEREA 34 ans et ses trois enfants, Rebecca 12 ans, Esther 8 ans et Isidore 4 ans ; Sarah NAMER 47 et ses quatre enfants, Maurice 18 ans, Dona 15 ans, Claire 12 ans et Fanny 9 ans ; Sarah SEMEL 34 ans avec Salomon 2 ans et Isabelle qui n’a que 9 mois ; Louise SZWARCBART et son bébé Bernard ; Zurek et Golda WAPNIARZ, âgés tous deux de 42 ans et leurs trois enfants, Régina 8 ans, Robert 3 ans et Joseph 1 an.
- Drancy – 3 : 67 partants. Parmi les enfants, Georges et Fernande BLACHMANN, 4 et 2 ans ; Berthe et Denise LEMEL, 13 et 9 ans ; Lucienne PORJES 1 an ; Blanche SKRZYDLAK 9 ans.
Bien qu’inscrite sur les listes de déportation du convoi 47, Denise LEMEL, née en France contrairement à sa sœur, a pu sortir de Drancy. Mais elle fut de nouveau arrêtée et déportée en 1944 par le convoi 77.
- Hôpital – Hospice – Orphelinat : Les nazis complétaient les effectifs avec les malades, les fous, les vieillards et les petits enfants, tous mêlés dans cette liste : Théodore BAKRA 83 ans ; Gitel MENDELEVITCH 91 ans ; Esther KRIMER 84 ans ; Caroline NEUMANN 82 ans ; Bertha SCHMULEVITZ 85 ans ; Kiva MAKLINE 80 ans ; Gitla WAJSELFISZ 84 ans ; Fania KRILITCHEVSKI 87 ans ; Marie DREYFUSS 86 ans ; Maria KOHN 80 ans ; Peisach LINKER 70 ans et 15 septuagénaires. Parmi les enfants : Edith BECKER 12 ans ; Sarah BEZNOVENNU 11 ans ; Berthold BODENTHAL 9 ans ; Marguerite et Simon BOGAERT, âgés de 14 et 8 ans ; Ruth BUNTMANN 10 ans ; Esther DON 11 ans ; Jacques FISZEL 4 ans ; Victor GRUMBERGER 6 ans ; Emile HUBER 12 ans ; Gaston KAHN 7 ans ; Marie-José et Henri KLAYMINC 14 et 10 ans ; Leib KUZKA 10 ans ; Sarah Lerer 13 ans ; Joseph, Zelman et Jeanine LIPSZYC, âgés de 11, 8 et 3 ans ; Gisèle MESSINGER 12 ans ; Joseph et Augusta SKOULSKY, âgés de 10 et 5 ans ; Mina, Lola et Simone STERNCHUSS âgées de 9, 6 et 4 ans …
- Partants de dernière heure : 19 personnes.
Les conditions de ce départ étaient si abominables que, dès la gare du Bourget/ Drancy, une des déportées, Linda GEBER, 64 ans, succombait ; c’est ce que nous apprend une annotation manuscrite de Röthke sur la liste du convoi. À l’arrivée à Auschwitz, le 13 février, 143 hommes furent sélectionnés et reçurent les matricules 102139 à 102280, ainsi que 53 femmes, avec les matricules 35290 à 35342. Tout le reste du convoi fut immédiatement gazé. Il y avait, en 1945, 10 survivants, dont 1 femme.
Ce convoi est composé notamment de 314 personnes nées en Pologne, 156 en France, 81 en Ukraine, 57 en Allemagne, 56 aux Pays-Bas, 44 en Turquie, 43 en Roumanie, 40 en Grèce, 29 en Belgique, 27 en Hongrie, 17 en Russie, 16 en Biélorussie, 13 en Lituanie, 12 en Bulgarie, selon le découpage des frontières en 2021.
Devan
Regina Kwartler née le 24/02/1904 (?) en Pologne, mariée à Schabsé Fanchel. Ils ont eu plusieurs enfants, ils résidaient au 9 avenue Allary à Limeil Brévannes. Elle fut arrêtée le 02/02/1943 internée à Drancy puis déportée à Auschwitz le 11/02/1943 par le convoi n°47 ainsi que les enfants par le convoi n°48, son mari lui a été déporté le 31/07/1944 par le convoi n°77.
Elle figure sur le mur des déportés au mémorial de la Shoah dalle n°27 colonne n°9 rangée n°3. (Mémorial).
Le dossier de Regina, numéro 65 8 17, conservé à Caen, ne nous apprend que peu de choses. Le 2 mai 1949, Berthe obtient l’acte de disparition de sa mère. Sa carte d’identité, délivrée aux étrangers sous le numéro 39 AS 68 675, indique qu’elle n’a pas de profession. Son décès est transcrit par un jugement du 13/12/1950 à la mairie de Brévannes le 10/02/1951, signé par Marius Dantz, le maire. On y trouve toutefois un courrier de Louis Véron, notaire à Boissy Saint-Léger, qui apprend à Berthe qu’elle bénéficiera d’une exonération des droits de mutations car Regina est décédée des suites de blessures de guerre. Le 7 janvier 1957, Regina est déclarée déportée politique. Ses filles recevront en avril un pécule de 32 000 francs. Elle obtient en outre le statut de morte en déportation le 14/11/1986.
Un courrier du dossier relate la tenue d’un conseil de tutelle à Brévannes, qui attribue la garde de Raymonde à Berthe Odette, le 8 février 1952.
Source : SHD
Les enfants déportés : Claude, Maurice, Fernand, Suzy, Roland
Convoi n° 48 en date du 13 février 1943
Extrait du Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld, édition de 1978. Notices des convois mises à jour par Jean-Pierre Stroweis.
Le 6 février, le chef du service anti-juif de la Gestapo, Röthke télexe à Berlin [XXVc-203 et XXVc-204] et à la Sipo-SD de Metz, qu’il y aura un troisième convoi en février, le 11 ; départ à la même heure (10 h 15) et avec le même nombre de Juifs. Est prévue pour ce convoi la déportation de Juifs français emprisonnés pour avoir enfreint les lois (voir notices des convois 46 et 47). Le télex habituel à Eichmann et au camp d’Auschwitz est envoyé le 13 février par Röthke, qui informe ses destinataires que, le même jour, à 10 h 10, un convoi de 1 000 Juifs a quitté la gare du Bourget/Drancy en direction d’Auschwitz, avec pour chef d’escorte, le lieutenant Nowak. Une note de Röthke du 16 février [XXVc-207] indique qu’il a fallu faire partir le convoi avec des forces allemandes et que malgré ses hésitations initiales, la police française a fini par coopérer, lors du départ du train. Le convoi comprenait 466 hommes, 519 femmes et 15 indéterminés. 150 enfants de moins de 18 ans et près de 300 de moins de 21 ans. Cette liste est en très mauvais état ; des perforations du classeur ont mutilé des noms, qu’il a fallu patiemment reconstituer. Ce convoi comprenait exclusivement des Juifs de nationalité française. D’ailleurs le titre de la liste est le suivant : « liste de mille Français ». Les déportés étaient domiciliés dans la région parisienne. La liste est divisée en trois :
- Drancy – escalier 2 : 388 noms. Parmi eux de nombreuses familles : Rebecca et Isaac ALVO et leurs quatre enfants, Juliette 18 ans, Victoria 17 ans, Jacques 11 ans et Rachel 7 ans. Mendel et Mindla ARM, âgés de 59 et 51 ans, et leurs 7 enfants, Hinda 19 ans, Berthe 15 ans. Marcel 13 ans, les jumeaux de 10 ans Charles et Jeanine, Paulette 7 ans et Daniel 5 ans ; Haim et Hélène LEIBA, âgés de 50 et 59 ans, et leurs cinq enfants, Adèle 23 ans, Marcel 21 ans, Paulette 19* ans, Jacqueline 17 ans et André 15 ans ; Joseph et Esther MANTEL, âgés de 37 et 36 ans, et leurs quatre enfants, Salvator 14 ans, Renée 10 ans, Rosette 9 ans et Jacqueline 1 an : les 5 enfants FANCHEL déportés sans leurs parents ; Claude 17 ans, Maurice 16, Suzy 13 ans, Fernand 11 ans et Raymonde qui n’a que 6 mois ; Herman et Filica AVRAM, âgés de 35 ans, et leur fils Christian 1 an ; Chana EPSZTEIN, 38 ans et ses deux fils, Abraham 7 ans et Charles 5 ans ; Lydia JUSSIM 4 ans ; Jean et Serge SENDERS, tous deux âgés de 6 ans ; Régina et Édith WETZSTEIN, 10 et 3 ans ; Ginette et Sylvain ZIEMAND, âgés de 7 et 5 ans.
- Drancy – escalier 1 : 340 noms. Parmi eux, Pierre GRUMBACH 11 ans ; Pierre GUMPEL 10 ans ; Cécile LANDAU 10 ans et sa sœur Fanny 7 ans ; Alice LÉVY 10 ans ; Suzanne LÉVY 2 ans ; Léa et Rachel ZAWIDOWICZ 13 et 12 ans.
- Drancy – escalier 3 : 263 partants. Parmi les enfants, Berthe ALEXANDRE 3 ans ; Philippe NOZEK 10 ans ; Léon et Esther SZEJMANN, 6 et 10 ans ; Szmul WEBERSPIEL 2 ans ; Roland FANCHEL 5 ans, dont les frères et sœurs sont dans la liste de l’escalier 2 ; Claude ATTALI 9 ans ; Jean et Claude SILBERSCHMIDT, de 4 et 2 ans ; Pauline, Raymonde et Jeanine YAKIR, âgées de 14, 13 et 11 ans.
Ce convoi est arrivé à Auschwitz, le 15 février. 144 hommes furent sélectionnés et reçurent les matricules de 102350 à 102492, ainsi que 167 femmes avec les matricules de 35357 à 35523. Le reste du convoi fut immédiatement gazé. En 1945, on comptait 12 survivants, dont une femme.
Claude FANCHEL 01/04/1925 -18/02/1943
« Morte en déportation », à 17 ans, arrêté du 24/12/2013. JO du 19/02/2014, Numéro de convoi : N°48.
Claude Fanchel est née le 01/04/1925 à Berck (France). On n’a pas retrouvé son acte de naissance dans les archives de Berck mais elle figure sur la table décennale. Elle est la fille de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Claude est arrêtée le 02/02/1943, internée à Drancy et déportée à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Suzy, Roland, Maurice et Fernand. Elle décède le 18.
Source : JORF.
Maurice FANCHEL 13/01/1927 – 18/02/1943
« Mort en déportation », à 16 ans, arrêté du 24/12/2013. JO du 19/02/2014 ; Numéro de convoi : N°48.
Maurice Fanchel est né le 13/01/1927 à Paris 19e (France). Il est le fils de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Maurice est arrêté le 02/02/1943, interné à Drancy et déporté à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Claude, Suzy, Fernand et Roland.
Source : Archives municipales de la ville de Paris.
Source : JORF.
Suzy Clara FANCHEL 13/03/1929 – 18/02/1943
« Morte en déportation » à 14 ans, arrêté du 13/05/2014. JO du 11/07/12014 ; Numéro de convoi : N°48.
Suzy Fanchel est née le 13/03/1929 à Paris dans le 11e arrondissement. On n’a pas retrouvé son acte de naissance. Elle est la fille de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Suzy est arrêtée le 02/02/1943, internée à Drancy et déportée à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Claude, Roland, Maurice et Fernand.
Source : JORF.
Le 05 mai 2025, grâce à Geneviève et Guy Lassalle, j’ai recueilli le témoignage téléphonique de Josette, née en 1932, âgée de 93 ans aujourd’hui.
“J’ai toujours vécu à Brévannes, et durant la guerre, je vivais Place des Marronniers. Brévannes a été bombardée par les Allemands qui visaient Villeneuve-Saint-Georges, il y avait l’occupation. Quand j’étais au cours moyen, j’allais à l’école Anatole France avec Suzy Fanchel. Suzy était une fille agréable, souriante, facile à vivre et très dynamique. Elle venait d’une famille aimante et très soudée. Ses parents étaient des « gens bien ». Suzy portait l’étoile jaune, et pour autant, elle n’a jamais été malheureuse avec ses camarades de classe, on ne faisait pas de différence. Un matin, Suzy n’est plus venue à l’école et on ne l’a jamais revue.”
Josette a su ce qui est arrivé à Suzy après la guerre quand Berthe Odette est revenue vivre dans la maison de ses parents avec son neveu Roland. Elle n’a pas connu les frères de Suzy : Maurice, Fernand et Roland car à l’école, à l’époque, les filles et les garçons étaient séparés en classe. Son frère lui, les connaissait bien, mais hélas il est décédé et il ne peut plus nous en parler.
J’ai également pu recueillir le témoignage de Solange, brévannaise de toujours, 95 ans, particulièrement investie dans l’association qui organise des thés dansants « Les fils d’argent ».
“Pendant la guerre, de nombreuses familles ont disparu car elles étaient israélites. Les Fanchel avaient une très belle maison. Les Allemands avaient peur de Brévannes car il y avait la tuberculose au sanatorium. C’est le bruit qui court.
Je vivais chez mes grands-parents, au 13, avenue Delaporte. En effet à Paris, à cause des bombes, on devait se cacher dans les caves. Mes parents ont choisi de m’envoyer à Brévannes. On ne se cachait pas, on ne manquait de rien, mais c’était une époque épouvantable. J’allais chercher de l’herbe pour les lapins, j’allais glaner. J’étais en classe avec mademoiselle Marchand, directrice et institutrice à Anatole France, en classe de première. A cette époque, il y avait quatre classes dans l’école des filles, de plus de 30 élèves chacune, entre 6 et 14 ans. Nous avions aussi un professeur de sport, Mme Malek et un professeur de chant, madame Materne. Suzy Fanchel était dans ma classe, avec madame Nampon et madame Soubriez. C’était une jeune fille menue. Un matin, les Allemands sont venus l’arrêter dans notre classe. On a simplement su qu’elle avait été déportée, c’était tout. Après la guerre, on a eu de tristes nouvelles. On ne savait pas ce qui était arrivé aux juifs, on n’en parlait pas. Beaucoup de familles ont disparu comme les Fanchel et les Lapinski.”
Source : Cours de gymnastique RSF espérance, mai 1943, avec l’aimable autorisation de madame Faluère
Suzy ne figure pas sur cette photographie, datée de mai 1943, mais ses amies de l’école Anatole France y sont réunies.
Fernand FANCHEL 18/02/1932 -18/02/1943
« Mort en déportation » à 12 ans, arrêté du 13/05/2014. JO du 11/07/2014 ; Numéro de convoi : N°48.
Source : Archives municipales de la ville de Paris
Fernand Fanchel est né le 18/02/1932 à Paris 11e (France). Il est le fils de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Fernand est arrêté le 02/02/1943, interné à Drancy et déporté à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Claude, Suzy, Maurice et Roland.
Le mercredi 7 mai 2025, je me suis rendue à la résidence Happy senior, située à l’emplacement de l’ancienne place des marronniers, avec Guy Lassalle. J’ai pu y rencontrer Bernard Berton, brévannais depuis sa naissance, qui lui aussi a bien connu les Fanchel et particulièrement Fernand, surnommé Freddie.
“J’ai habité durant 92 ans sur le terrain où je suis né, à Brévannes. Ma famille est Brévannaise depuis quatre générations, depuis 1898. Je suis cependant d’une famille moins ancienne que la famille Brun qui est arrivée en 1895.
J’ai perdu ma mère au début de la guerre. À cette époque, mon père était parti en Allemagne comme prisonnier dans un camion neuf, un camion Renault car il transportait des animaux à La Villette. Comme mon père était veuf de guerre, il a fait partie de la première relève du Maréchal Pétain. Je suis allé l’attendre à la Gare du Nord, le 24 novembre 1942. Il est revenu sans camion. Quand il est rentré, il n’avait plus de chaussures. Alors mon grand-père a été voir le père Fanchel qui était « un cordonnier de Bouif ». Mon père lui a donné des rennes de chevaux, et avec cela, il lui a fabriqué des galoches. C’est le même Docteur qui m’a mis au monde que Solange. Il s’appelait le docteur Ringard, il était correspondant de guerre. Solange était toujours avec Suzy. J’étais ami avec Fernand, j’allais souvent jouer chez lui avenue Allary.
La déportation. Cela s’est passé en 1943. J’étais en classe avec Fernand, nous avons été dans la même classe durant deux ans. Notre instituteur s’appelait Marcel Proust. C’est vrai. C’était un dur. Il était là avant la guerre, puis il est revenu de mobilisation en décembre 1941. En son absence, on a rappelé des retraités comme le père Chassagne.
Je le vois encore, Fernand, il est à côté de moi, avec son étoile jaune.
On raconte beaucoup de choses sur la famille Fanchel : on raconte que le père aurait donné une fortune pour sortir Raymonde de Drancy. On raconte aussi que la fille aînée aurait échappé à la déportation car elle était mariée. Voilà ce qu’on disait.
Quand les Américains sont entrés à Brévannes, le 25 août 1944, on mangeait des tomates farcies au cyprin, que j’allais pêcher dans les étangs des sablières de l’avenue du 8 mai 45. Je me souviens également que quand le premier train a pu circuler de nouveau entre la gare de Limeil et celle de Brie-Comte-Robert, la locomotive était toute entière couverte de roses. À cette époque, j’allais souvent chez ma grand-mère à Périgny, il y avait beaucoup de roseraies.”
Après avoir discuté avec Bernard, j’ai découvert que j’avais enseigné à ses petites filles, Laura et Cindy, il y a plus de 20 ans, à mon arrivée au collège Daniel Féry. C’est un personnage de Brévannes qui connaît énormément de choses sur l’histoire de la commune.
Source : JORF.
Roland FANCHEL 25/07/1937-18/02/1943
« Mort en déportation » à 5 ans, arrêté du 13/05/2014. JO du 11/07/12014 ; Numéro de convoi : N°48.
Roland Fanchel est né le 25/07/1937 à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne, France). Il est le fils de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Roland est arrêté le 02/02/1943, interné à Drancy et déporté à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48.
A Drancy ce petit garçon de 5 ans est séparé de ses frères et sœurs.
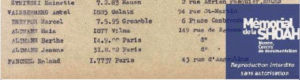
Source : Archives du mémorial de la Shoah
Lina
Archive Mémorial de la Shoah
Le sujet de l’archive est un extrait de la liste originale d’un convoi de déportation.
Elle nous donne une liste de noms des personnes qui ont fait partie du convoi partie le 13 février 1943 de Drancy à destination d’Auschwitz, convoi 48. Sur l’archive, on peut lire les informations suivantes : les nom, prénom, date de naissance, adresse et ville d’habitation des personnes. Il y a des personnes de tout âge, enfants et adultes, qui viennent de toute la France, des femmes et des hommes. Les informations écrites sur l’archive sont tapées à la machine à écrire. Sur cette archive, il y a un membre de la famille tel que l’on étudie. Son nom est sur la liste des personnes. Roland Fanchel, né le 1er juillet 1937
Il résidait au 43, rue d’Angoulême à Paris. Grâce à cette archive, j’ai appris que des habitants ont été déportés comme Roland. Dont la date de naissance n’est pas correcte puisque nous savons qu’il est né le 25 juillet 1937, il n’avait que cinq ans quand il a été déporté. Son nom est inscrit sur le mur des noms. Dalle, numéro 13, colonne numéro cinq, rangée numéro une.
Source : JORF
L’Arrestation et la déportation de Schabsé
On sait peu de choses du devenir de Schabsé, Berthe et Raymonde, les trois membres restants de notre famille entre février 1943 et juillet 1944. Raymonde a miraculeusement échappé à la déportation, sauvée par l’UGIF. Mais le 03 juillet 1944, Schabsé et Berthe sont arrêtés.
Agata : S. Fanchel est arrêté le 3/07/44 car il est inscrit sur une liste de la préfecture de Seine et Oise (Archive Convoi 77).
Schabsé est arrêté en même temps que Berthe à son domicile le 3 juillet 1944, pour motif racial, il transite par Maisons-Laffitte avant de rejoindre Drancy. Il est accompagné de Nathan et Régina Potzeha dont nous avons raconté l’histoire.
Madeleine
Cette archive date de 14/10/1957, elle donne l’État Civil de S. Fanchel : fiche de contrôle qui retrace les arrestations de S. d’abord Maisons-Laffitte puis Drancy. (Archive Mémorial de la Shoah).
Tasnim
Cette archive vient du camp de Drancy. Elle concerne Schabsé Fanchel, elle nous apprend qu’il est arrêté le 3 juillet. Elle nous apprend le contexte historique et constitue un appel à la mémoire.
Source : Mémorial de la Shoah
Mohammed
À son arrivée à Drancy, il a 1695 francs selon son reçu. Son matricule est le 24695.
Selon Anaëlle Riou, 60 personnes déportées du Convoi 77 sont arrêtées en Seine et Oise, dont 56 en juillet 1944. “La persécution des Juifs s’aggrave à mesure que la Libération approche et c’est sans plus aucun scrupule à l’égard des autorités françaises que les Allemands procèdent à des arrestations dans toute la France, sans distinction de nationalité, ni d’âge.” Seules 4 personnes dont Schabsé transitent par Maisons- Laffitte avant d’aller à Drancy dont nos 3 brévannais.
Une micro-histoire de la Shoah en France. La déportation des Juifs du convoi 77 Anaëlle Riou, Université de Caen, 2019
A cette date, sa femme et ses autres enfants ont déja été arrêtés. Il est arrêté pour motif racial “de race juive” ou “israélite” par la Feldgendarmerie de Corbeil, d’après une liste émise par la Préfecture de Seine et Oise. Il est indiqué que sa situation financière est aisée.
Sont déportés par le convoi 77, le 31 juillet 1944, 1306 personnes, dont de nombreux enfants raflés par Aloïs Brunner, ainsi que le père d’Ida Grinspan.
Cité par Anaëlle Riou, ce texte retrace les conditions de départ du convoi :
31 juillet 1944, gare de Bobigny. Quand le jour du départ du convoi approche, les internés l’apprennent la veille. « Tout est organisé pour qu’il n’y ait aucun retard au niveau des autobus qui mènent à la gare, et au niveau de l’embarquement dans les wagons. » S’ensuit un rituel de terreur consistant à enfermer les internés appelés au départ dans un espace fermé par des barbelés, où les hommes sont rasés et fouillés, les femmes sont fouillées et dépouillées de tous leurs bijoux. Puis ils passent tous la nuit dans les bâtiments de débarras Le lendemain matin, très tôt, les SS accompagnent les internés à coup de matraques jusque dans les autobus qui doivent les conduire à la gare de Bobigny. Les instructions à l’égard des autres internés sont très claires : « à la suite d’instructions particulièrement sévères qui m’ont été données par le M. le SS Hauptsturmführer Brunner, il est strictement défendu d’ouvrir les volets en fer des fenêtres demain à partir de 6h du matin
jusqu’au départ du dernier autobus. Personne ne devra être aux fenêtres. Les sanctions prévues sont très sévères. »
Dans le cas du convoi 77, le premier départ en autobus s’est fait à 7h10 : « La descente dans la cour aura lieu demain à 6h30. Le premier groupe à partir devra être prêt à 7h. Départ du Ier autobus à 7h10. L’appel sera fait par les soins des Effectifs. »
Arrivée au camp : Ce dont nous sommes certains c’est que le convoi arrive en pleine nuit, probablement entre le 3 et le 4 août 1944, vers 3 heures du matin. Il s’arrête à l’intérieur de Birkenau. En effet, depuis le mois de mai 1944, les déportés ne débarquent plus sur la Judenrampe. « Il faisait nuit noire, des projecteurs éclairaient la route. Le train s’était arrêté à l’intérieur du camp. Il n’y avait pas de gare. » Les Juifs descendent et sont sélectionnés pour les chambres à gaz ou le travail, mais aucun des deux groupes ne connaît encore le sort que lui réserve le médecin du camp en charge du tri des déportés.
En tout, ce sont 890 déportés sur les 1294 qui composent le convoi 77 qui ont été gazés dès leur arrivée et très exactement 425 femmes et 465 hommes. Ils étaient âgés de 15 jours à 88 ans.
Schabsé décède le 03 ou le 4 août 1944 à Auschwitz en Pologne. On n’a pas de traces de son passage à Auschwitz. Il a disparu.
Hanaé
Archives du mémorial de la Shoah.
Il s’agit d’une liste de déportés de différents convois.
On y apprend que Schabsé est déporté par le convoi 77.
Source : Mémorial de la Shoah
Adam
Mon archive (Convoi 77) parle du décès de Schabsé Fanchel en Pologne.
Source : Mairie de Limeil-Brévannes
Maïssane
J’ai travaillé sur l’acte de décès de S.Fanchel (archive mairie de LB), elle donne des informations sur sa vie. Né en Russie en 1880, il a résidé à Limeil Brévannes, puis a été déporté à Auschwitz où il décède.
Claude est une de ses filles. Elle est née le 1er avril 1925 à Berck sur mer dans le Pas-de-Calais. Elle a aussi habité à Limeil-Brévannes au 9, avenue Allary. Nous ne savons pas quelles sont les causes de son décès.
Se reconstruire : histoire des survivantes
Berthe la fille aînée et Raymonde la cadette ont échappé à la déportation
Berthe Odette Fanchel
Source : Photographie de la tombe du cimetière de Bagneux, P.Deweerdt
Berthe Odette est née le 30/10/1921 à Paris, dans le 4e arrondissement, elle est décédée le 4 juillet 1976 à Fontenay les Briis (Essonne), elle a été reconnue par son père le 10/01/26 et par sa mère le 12 septembre 1922. Dans les recensements, on la trouve sous le nom de Kwartler mais elle porte le nom de son père dans sa vie d’adulte.
Source : archives municipales de la mairie de la ville de Paris.
C’est une bonne élève comme on le voit sur le journal le Temps : en 1931, elle fait partie des élèves les plus souvent nommées du Lycée Victor Hugo (en classe de 9e).
Source : Gallica.
On sait assez peu de choses de la vie de Berthe durant la guerre, si ce n’est qu’elle est surveillée par les Allemands comme le montre cette archive :
“À la fin de l’année 1942, la troisième section de la direction générale, des renseignements généraux et des jeux, a effectué de nombreuses surveillances, domiciliaires et vérifications dans le but de découvrir, et punir des juifs en infraction avec les lois, décret et ordonnance ou qui auraient pu se livrer à une activité politique quelconque”. Ce document nous apprend que Berthe Odette et son père ont été arrêtés pour défaut du port de l’insigne, puis relâchés sur instruction de Monsieur le SS Hauptsturmführer HEINDON.
Source : archives de la Préfecture de police
Elle a été arrêtée avec son père à leur domicile de Brévannes le 03 juillet 1944 mais pas déportée, on n’a pas d’explications à ce sujet.
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Berthe Odette sera la tutrice de sa sœur Raymonde, pupille de la nation, adoptée par l’Etat le 5 février 1953.
A la fin des années 40, elle vit 12, rue du Moulin de la Pointe à Paris (13e), ce domicile a été racheté par Joseph Birolo que nous vous présenterons plus tard, il appartenait à Régina Kwartler.
Après la guerre, Berthe Odette, que ceux qui l’ont connue décrivent comme une femme forte, courageuse, mène de front sa carrière professionnelle, l’éducation de Raymonde et les nombreuses démarches pour faire reconnaître le décès de ses parents, de ses frères et soeurs et le règlement de la succession Fanchel-Kwartler. Les nombreux documents conservés au SHD de Caen pour retrouver les membres de sa famille disparus, les courriers d’avocats pour la reconnaissance de Raymonde, les courriers émanant d’un autre cabinet concernant leur succession…
Elle est aujourd’hui enterrée à Bagneux avec Sarah Fanchel, sa tante, Raymonde sa petite soeur (et d’autres membres de leur famille, Jacques Tokar et sa femme Eliane).
Source : P. Deweerdt
Sur le caveau, on remarque une inscription :
Crédit : P. Deweerdt
A la mémoire de nos chers parents Joseph et Pessa Klaiman déportés à Auschwitz[16].
A nos grands-parents, Schabsé Fanchel et Régina Kwartler, disparus en déportation.
La tombe de la famille Tokar, adossée à celle des Fanchel, nous apprend qu’il existe un lien de filiation, entre Schabsé et Chana qui sont fils et mère. Et certainement entre Rachel et Schabsé qui seraient frère et soeur. On sait que la famille Tokar et la famille Fanchel ont vécu dans le même quartier et sont liées par des transactions commerciales. Le dossier de naturalisation d’Israël Tokar mentionne d’ailleurs les Fanchel comme référence.
Crédit : P. Deweerdt
Raymonde FANCHEL
Source : photo de la tombe de Bagneux, P. Deweerdt
Jo-Yie
Le document est un acte de naissance appartenant à Raymonde Fanchel, cette personne du sexe féminin est l’une des sept enfants de Schabsé Fanchel. Le 22 juin 1942, à 13 heures vingt minutes à l’avenue Allary 9 est née Raymonde. Son père est un commerçant, né le 5 mars 1880 dans une ville en Russie, il déclare reconnaître Raymonde. Dressé le 23 juin 1942, à onze heures trente sur la déclaration du père, qui a fait la lecture de l’acte, a signé avec le Maire de Limeil-Brévannes. Raymonde Fanchel meurt à l’âge de 66 ans, le 14 juin 2008 à Saint-Maurice (Val de Marne). À partir de cette archive j’ai compris qu’un acte de naissance inclut la date, l’heure, les minutes et le lieu de naissance, les informations des parents… Comme pour Raymonde, on apprend toutes les informations sur elle et ses parents. Tels que le métier, le lieu de naissance de Schabsé… (Mairie de LB).
Diego
(Archives Mairie LB)
J’ai étudié l’acte de naissance de Raymonde. Elle est née le 22 Juin 1942, à Brévannes, d’un père originaire de Russie et d’une mère de Pologne. Ils y habitaient. Elle est décédée le 14 février 2008 à Saint-Maurice.
Source : Mairie de Limeil-Brévannes.
Raymonde Fanchel est née le 22/06/1942 à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Elle était la fille cadette de Régina Kwartler et de Schabsé Fanchel et la sœur de Berthe Odette, Claude, Maurice, Suzy, Fernand et Roland. Schabsé déclare la reconnaître lorsqu’il va la déclarer en mairie le 23 juin. Sa mère, Régina, n’a sans doute pas eu le temps de le faire. Un jugement déclaratif du tribunal civil de la Seine en date du 11 mars 1958 stipule que Raymonde est bien la fille de Régina. Raymonde, âgée de huit mois, est arrêtée le 02/02/1943 avec sa mère et Claude, Maurice, Suzy, Fernand et Roland. Tous sont internés à Drancy le 03/02/1943. Âgée de huit mois, Raymonde est transférée dans une maison d’enfants de l’UGIF le 22/02/1943 comme l’atteste la lettre de Léo Israelowicz adressée le 19/02/1943 à Monsieur François, directeur des affaires administratives de la police générale de Paris, au sujet des demandes de libération des détenus internés à Drancy (CDXXIV-44 p.120), c’est le dernier ordre de libération qu’il signera avant d’être arrêté et déporté. C’est une enfant bloquée. Raymonde[17] échappe ainsi à la déportation, même si elle apparaît sur la liste du convoi 48, car il est prévu qu’elle soit déportée.
Source : Archive du mémorial de la Shoah
Madeleine, Hanaë, Irem
Cette archive date du 19/02/1944. C’est un courrier destiné au directeur de la préfecture de police, écrit par Léo Israelowicz. Cette lettre concerne des personnes libérées (ordre de libération). Elle cite des personnes en donnant leur âge et leur adresse. Nous apprenons que Raymonde Fanchel a été libérée et transférée dans une maison d’enfants à 8 mois.
Lina, Jaya, Maïssane
Cette archive est une lettre de la préfecture de police de Paris envoyée à Monsieur le directeur du camp de Drancy. Elle date du 19 février 1943. Elle concerne une liste de personnes âgées et un enfant, Raymonde, huit mois qui doit être transférée. Elle nous apprend donc que Raymonde Franchel n’a pas été déportée.
Néanmoins, il subsiste la page d’un registre tenu par le Père Devaux pour les enfants pris en charge pendant la guerre : nom et prénom, date de naissance, lieu de résidence de l’enfant, nom des répondants, nom de la personne prenant en charge l’enfant, qui nous a été transmis par Héléna RIGAUD, Archiviste des sœurs de Notre-Dame de Sion[18]. Raymonde a sans doute été transférée d’une maison de l’UGIF à une famille au moment où les maisons de l’UGIF sont raflées.
Source : registre tenu par le Père Devaux pour les enfants pris en charge pendant la guerre, transmis par Héléna RIGAUD, Archiviste des sœurs de Notre-Dame de Sion.
Diego et Devan
Cette archive nous apprend que Raymonde change de nom de famille pour Colombel. Elle est cachée par monsieur Birolo en 1944 à l’âge de 2 ans. Il reçoit de l’argent (deux fois 900 euros) pour payer la pension de la nourrice de Raymonde, madame Le Louarec.
Monsieur Joseph Birolo, de nationalité italienne, né en 1894, est le répondant de Raymonde Fanchel dite Colombel pendant sa prise en charge par Mme Le Louarec, nourrice. En 1946, il vit au 72, rue du Château d’Eau avec les sœurs Fanchel (Raymonde est indiquée comme étant sa filleule).
Source : recensement de la ville de Paris, 1946.
D’après le journal La loi des 11 et 29 mars 1944, monsieur Birolo achète un fonds de commerce de Régina situé 12, rue du Moulin de la Pointe dans le 13e arrondissement de Paris :
Source : Gallica.
Source : Gallica.
Raymonde a donc miraculeusement survécu à la déportation de sa mère par le convoi 47, parti de Drancy le 11/02/1943 et de ses cinq frères et sœurs déportés par le convoi 48, parti de Drancy le 13/02/1943 à destination d’Auschwitz. On ne sait pas comment sa sœur la retrouve.
Son père, Schabsé est quant à lui déporté par le convoi 77 parti de Drancy le 31/07/1944.
Sa sœur aînée Berthe devient sa tutrice après la guerre (documents présents dans le dossier DAVCC 21 P 448 583 de leur père Schabsé Fanchel et questionnaire rempli par Berthe Odette à l’institution Notre-Dame-de-Sion sous la cote DI (100).
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Jo-Yie et Nola
Le document est une archive sur les informations de la vie de la famille Fanchel. Ils ont disparu avec leurs cinq enfants. Le père était commerçant et habitait rue d’Angoulême à Paris. Son épouse, Regina, est née en Pologne. Les noms des Fanchel restants sont Berthe et Raymonde. Berthe est la seule personne qui est destinataire du courrier. Le père a été arrêté en juillet, la mère en février 1944 avec cinq enfants. Ils ont été déportés. Ce document est destiné à essayer de définir ce qu’il est arrivé après la guerre.
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Comme Régina et Schabsé n’étaient pas mariés, Berthe doit faire reconnaître que sa sœur est bien la fille de sa mère. Comme l’indique la mention apposée à son acte de naissance, elle est reconnue par jugement du tribunal de la Seine le 11 mars 1958 comme la fille de Regina à titre posthume, ces documents, conservés aux archives de Paris, sont incommunicables car trop récents.
Source : Archives de monsieur Journo avec son aimable autorisation.
Source : Archives municipales de Limeil-Brévannes.
Berthe va faire de nombreuses démarches et demandes concernant sa famille. Elle établit d’abord une demande afin d’obtenir pour son père le statut de non rentré (déposée à Villeneuve Saint-Georges) le 15/10/1949[19].
La reconstruction des familles ou des rescapés est également passée par les demandes de titres « Déporté Politique » ou « Déporté Résistant ». Ces titres apportent aux familles une reconnaissance de l’Etat mais également une forme de compensation financière. Il était particulièrement difficile de prouver son arrestation en tant que résistant. Aussi, 23 déportés n’ont pas obtenu le titre de Déporté Résistant mais admis à celui de Déporté Politique. Quant aux déportés reconnus Déportés Politiques, ils sont 684 à avoir bénéficié de cette reconnaissance.
Anaëlle Riou
Nola
La date de cette archive est le 16 mars. Il s’agit d’une demande pour régulariser l’état civil d’un « non-rentré ». Ce document semble lié à des questions administratives ou juridiques concernant l’identité ou le statut d’une personne qui n’a pas été enregistrée dans les registres civils. Ce que j’en apprends, c’est que ce type de document est souvent crucial pour établir des droits légaux ou pour accéder à des services administratifs. Cela montre également l’importance de la régularisation de l’État civil dans la société, car cela peut affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne d’une personne. (Archive convoi 77).
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Amayas
Mon archive est non-datée (pas de date de la délivrance du document) Le sujet de mon document est une demande formulée en vue d’obtenir la régulation de l’état civil d’un «non-rentré». Le document contient des informations concernant Schabsé Fanchel, sa date et lieu de naissance, la date de son décès, son adresse. Ce que j’ai compris du document : Schabsé Fanchel qui est né le 5 mars 1880 et est mort en 1944, vivait 9, rue Allary à Limeil-Brévannes. Schabsé Fanchel a été arrêté le 3 juillet 1944 à Limeil-Brévannes par les Allemands et a été déporté le 31 juillet 1944. Il avait beaucoup voyagé et il est venu vivre dans notre commune avec sa femme et ses sept enfants. (Archive convoi 77).
Elle obtient ensuite un acte de disparition :
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Berthe demande enfin le statut de mort pour la France pour son père, qui a voulu s’engager dans la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale mais elle essuie un refus, ne pouvant prouver son décès en déportation, dans la mesure où il n’y a pas de trace de son passage à Auschwitz.
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
On retrouve des documents dans une pochette verte intitulée Fichier de Brinon en référence à Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement de Vichy.
Il contient entre autres, l’acte de disparition de Schabsé, émis par le ministère des anciens combattants. Berthe dépose une demande de régularisation de l’état civil en 1949. Le maire de Limeil, Marius Dantz, transcrit le décès de Schbabsé et celui de Claude en 1950.
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen
En 1956, le dossier statuant de son sort durant la guerre est toujours en cours d’instruction :
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Ismaïla et Ismaël :
Cette archive date du 17 mai 1956 : elle provient de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, et s’adresse au bureau du contentieux. Elle concerne la déportation de Schabsé à Auschwitz, qui a été arrêté pour motif “racial” puis enfermé à Drancy et déporté. Cela nous précise qu’un acte de disparition a été établi le 8 novembre 1949
Elle effectue les mêmes démarches pour sa mère et ses cinq frères et sœurs.
Berthe et Raymonde touchent une somme de 12 000 francs en 1957 : c’est le pécule prévu par la loi dont le montant est calculé par mois d’internement. Le convertisseur de l’INSEE[20] estime que cela revient à 280 euros de 2023.
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Il est finalement accordé à Schabsé le titre de déporté politique, mais pas celui de mort pour la France. Son numéro de carte de déporté est le 117510784. Il obtient le statut de « Mort en déportation » par arrêté du 27/07/1989 au JO du 18/10/1989.
Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.
Naïm et Mohamed : L’archive date du 7 janvier 1957. L’archive traite d’une décision concernant l’attribution du titre de déporté politique par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre. Il s’agit d’un document officiel qui attribue le titre de déporté politique à Monsieur Fanchel, né le 5 mars 1880 en Russie. Le document, émis par la direction interdépartementale de Paris, précise que deux périodes de déportation sont reconnues : du 3 juillet 1944 au 30 juillet 1944 et du 31 juillet 1944 au 5 août 1944. J’ai appris que Monsieur Fanchel a obtenu le titre de déporté politique. Ce titre est une reconnaissance importante qui est accordée aux personnes ayant été emprisonnées ou déportées pour des raisons politiques. Il a donc été dans cette situation. (Archive convoi 77).
Ismaïla :
Même si j’ai pas très bien réussi à déchiffrer l’archive, j’ai essayé de faire de mon mieux pour exploiter les informations suivantes : elle vient du Ministère des anciens combattants et date du 12 juin 1953. Elle semble parler de la mort de Schabsé Fanchel. Donc cette archive Parle de la mort de Schabsé FANCHEL qui serait mort en Pologne, et dont la famille demande qu’il aie le statut de déporté. (Archive convoi 77).
Amayas et Adam :
L’archive date du 7 janvier 1957, elle parle de Schabsé. Elle nous apprend qu’il obtient le titre de déporté politique. Sa période d’internement va du 3 juillet 1944 au 30 juillet 1944. Cette archive vient de la Direction interdépartementale de Paris. Son numéro de déporté est le 117510784. Sa fille Berthe-Odette est destinataire du courrier.
Kylian et Fodye
L’archive est un courrier du ministère des anciens combattants qui est adressé à Berthe, domiciliée au 12, rue du moulin de la Pointe dans le 13e à Paris. Ce courrier est daté du 12/09/1957. Elle concerne la demande d’attribution du titre de déporté politique.
On ne sait que peu de choses de la vie des deux sœurs après la guerre. Berthe effectue de nombreuses démarches pour épauler sa sœur. Jusqu’en 1949, elle tente de faire valoir ses droits dans le dossier du fonds Le fonds 1900 W1 257 des Archives de Paris rassemble les dossiers d’expropriation et de d’administration des 7 et 9 rue des Jardins Saint-Paul appelé “Succession Kwartler”, on ne sait pas si elle a pu bénéficier de l’indemnité prévue pour sa grand-mère. Elle travaille comme sténodactylo à Créteil, vend sa maison de Limeil pour aller vivre à Villecresnes. Elle voyage à New York en 1962. Souffrant d’un cancer, elle décède en 1976.
Quand Raymonde meurt, en 2008, le montant restant sur son compte en banque n’est pas réclamé et placé à la Caisse des dépôts.
C’est alors que deux noms apparaissent au fil des recherches dans Geneanet : un certain monsieur Roland Schabsé FANCHEL, né à Londres le 29/09/1960 et décédé le mercredi 01 mai 2024 à l’hôpital de Draveil à l’âge de 63 ans… Ainsi que madame Suzie Nadia FANCHEL, née le dimanche 20 août 1967 à Villeneuve Saint-Georges (France) et décédée dans sa 34ème année le mardi 03 juillet 2001 à l’hôpital de Lons le Saunier, elle vivait à Cormoz dans l’Ain et travaillait sur les marchés. Ce sont tous les deux les enfants de Raymonde, comme leurs actes de décès nous l’ont appris. Détail important, Roland Schabsé, qui vivait à Morangis, avait été adopté par Berthe Odette, sa tante.
Maïssane :
On apprend que Roland Schabsé Fanchel est né le 29/09/1960 à Londres. Il est le fils de Raymonde, décédée. Il aurait été adopté par Berthe Odette Fanchel, célibataire. Il vivait à Gagny.
Le 03 juillet 2001 est décédée Suzie Nadia Fanchel, fille de Raymonde, célibataire. Elle habitait à Cormoz dans l’Ain.
Lina :
Roland Schabsé Fanchel est décédé le 1er mai 2024 à 12h30 à Draveil en Essonne selon la copie intégrale de son acte de décès.
L’autre fille de Raymonde, Suzie Nadia, est décédée le 03 juillet 2001 à 10h25. Elle était née le 20 août 1967 à Villeneuve Saint-Georges.
Les membres de la famille Fanchel décèdent un par un…
Quand j’ai écrit à l’État Civil de la mairie de Limeil-Brévannes pour demander des renseignements complémentaires concernant le domicile des Fanchel, l’adjoint au maire, monsieur Daniel Gasnier, qui avait reçu mon courrier, s’est souvenu qu’il y a une dizaine d’années, il avait été contacté par des cousins des Fanchel qui souhaitaient savoir ce qu’il était advenu de la maison de l’avenue Allary, sans que l’on retrouve ce courrier.
À la fin du mois de décembre 2024, après avoir reçu les copies des actes de décès de Roland Schabsé et Suzie Nadia, une question s’est imposée : si Raymonde avait eu des enfants, pourquoi son testament n’avait pas été retrouvé ? Et pourquoi ses enfants auraient-ils vécu et été enterrés si loin d’elle ?
Roland, lui, avait fait un testament : j’ai alors écrit à l’étude notariale en charge de sa succession. Il m’a été répondu que l’étude était tenue au secret professionnel.
Et puis quelques jours après, le 08 janvier, j’ai reçu un coup de fil d’un homme m’annonçant qu’il était le frère adoptif de Roland…
Jean-Noël Journo m’a expliqué son histoire : ses parents travaillaient avec Berthe Odette, secrétaire, à Créteil, dans les années 60. Elle avait officiellement adopté Roland, après avoir pris en charge Raymonde.
Raymonde menait une vie en marge de la société, malgré le combat de sa sœur pour faire reconnaître leurs droits.
Lors d’un séjour étudiant en Angleterre en 1960, avait accouché d’un fils, Roland Schabsé, le 29 septembre.
Source : Archives personnelles de monsieur Journo.
Elle a vécu 43 Belgrave road Leyton et 461 Romford road à Londres, puis est ensuite rentrée en France, et a fini par confier l’enfant à Berthe Odette comme le montrent la décision du tribunal de Bobigny en 1971 puis le jugement d’adoption du tribunal juillet 1976, postérieur au décès de Berthe le 04 juillet 1976.
Source : Archives personnelles de monsieur Journo.
La nourrice qui a eu Roland en charge entre septembre 1965 et 1970 a été payée par Berthe Odette et témoigne en sa faveur dans le dossier d’adoption.
Source : Archives personnelles de monsieur Journo.
Raymonde a ensuite accouché d’une fille, en 1967, à Villeneuve Saint-Georges, prénommée Suzie Clara, qui a sans doute été placée.
Berthe et Raymonde ont gardé des contacts réguliers malgré les difficultés de Raymonde.
Berthe vit alors à Villecresnes, au 2, rue Jean Cavaillès après avoir quitté Limeil-Brévannes.
En 1974, Berthe, se sachant malade, confie Roland à la famille Journo, des collègues de travail devenus des amis proches, qui ont déjà 8 enfants.
Le benjamin, Jean-Noël, a un an de moins que Roland et ils seront très liés.
Au décès de Berthe Odette en 1976, Raymonde disparaît de la vie de Roland. Elle garde des contacts sporadiques avec la famille Journo et meurt en 2008.
Roland tombe gravement malade en mai 2023 et désigne Jean-Noël comme son héritier.
À gauche Jean-Noël, à droite Roland Schabsé ; Source : Archives personnelles de monsieur Journo.
A la mort de Roland, Jean-Noël contacte le cimetière de Bagneux sans retrouver le caveau familial. Roland est donc enterré avec les parents Journo, à Pantin.
La maison du 9, avenue Allary a bien été vendue par Berthe, aujourd’hui la parcelle a été lotie et plusieurs demeures y ont été bâties.
Leur notaire, maître Lecaillon, m’a également appelée pour me raconter sa version de l’histoire. De cet échange particulièrement bouleversant, il ressort que Roland n’a pas connu Suzie, sa sœur cadette de 7 ans décédée très jeune.
Roland n’a pas entièrement eu connaissance de son histoire.
La notaire m’a alors confié que c’était un dossier qu’on ne voyait qu’une fois dans sa vie.
Berthe n’a pas pu ou pas su comment faire valoir ses droits quant aux biens qui ont été perdus pendant la guerre, elle n’a pas non plus eu de contacts après la guerre avec les Tokar, dont le nom a été francisé en Pacart et dont les descendants appartiennent à la génération de Raymonde.
La dernière pièce du puzzle a été posée.
Jean-Noël et moi avons déposé un dossier à la CIVS pour demander réparation des biens spoliés ou perdus durant la guerre.
En avril 2025, j’ai été contactée au collège par monsieur Guy Lassalle, brévannais féru de généalogie qui avait eu connaissance du projet Convoi 77 et souhaitait y apporter ses connaissances. Monsieur Lassalle a en effet des amis qui ont connu les Fanchel et ont notamment été à l’école avec Suzy.
Mon père n’aura hélas jamais connu l’épilogue de cette aventure, commencée en 2019.
Source : M-A Deweerdt
La famille Fanchel repose au cimetière de Bagneux, section 3, allée 15, tombe 5. Isaac est enterré allée 14 tombe 20. On ne sait pas où est Vincent, et la fille morte née de Rosa et Schabsé n’est plus à l’emplacement initial. Rosa est inhumée à Bagneux dans une tombe qui ne porte pas son nom. La famille Tokar a un caveau à son nom allée 16 tombe 5, où est inhumée Anna ou Hona Tokar alors qu’elle était auparavant à Limeil Brévannes dans une concession temporaire ; on a retrouvé les bons de commande de la maison Berton indiquant qu’il s’agit de concessions perpétuelles qui auraient été achetées par Schabsé. Il a d’ailleurs commandé un caveau de 18 places section 16, allée 10, place 11 où sont inhumés des membres de la communauté juive ashkénaze. J’ai pu rencontrer Pierre et Liliane Pacart en mars 2025. Pierre est le petit-fils d’Israël Georges Tokar et de Rachel Feinchel (Fanchel).
Ce travail d’enquête a été mené par la formidable classe de 4eC du collège Daniel Féry de Limeil-Brévannes.
Avec : Irem, Lina, Maïssane, Tasnim, Edison, Fodye, Agata, Devan, Nola, Salimata, Mohamed, Inassio, Ismael, Diego, Abigaelle, Madeleine, Ismaïla, Gabriel, Amayas, Lana, Elias, Maha, Jo-Yie, Jaya, Kyilian, Naïm, Hanae, Adam et Malak.
L’équipe du collège Daniel Féryest bien plus qu’une simple salle des professeurs comme on en trouve partout, c’est ce que montre le travail de ces élèves de 13 ans.
Remerciements :
Je remercie très chaleureusement Claire Podetti et Georges Mayer pour leur travail, leurs conseils, leur bienveillance ainsi que leur visite qui a permis à ce projet d’aboutir.
Merci aux États-Civils des mairies qui ont bien voulu nous répondre, tout particulièrement à Monsieur Gasnier de la mairie de Limeil-Brévannes, aux services d’archives que nous avons sollicités et bien entendu au Mémorial de la Shoah, tout particulièrement à Hanna et à l’équipe de Convoi 77.
Merci au formidable Guy Lassalle de Limeil-Brévannes, ainsi qu’à son épouse Geneviève pour leur appui et leurs précieuses connaissances, notamment les anciens camarades de classe des enfants Fanchel : Bernard, Solange et Josette.
Merci enfin à maître Gaëlle Lecaillon pour sa confiance et à Jean-Noël Journo, pour m’avoir permis de clore ces années de recherche.
Merci à Pierre et à Liliane Pacart de leur aide et de leur écoute.
Limeil-Brévannes, 27 Janvier 2025- Juin 2025
Liste mise à jour en juin 2025
Domiciles successifs occupés par les Fanchel-Kwartler ; biens immobiliers : fonds de commerce dont on ne sait pas ce qu’ils sont devenus durant la Guerre :
En 1946 ces numéros de la rue des Jardins Saint-Paul ne sont pas référencés dans le recensement (îlot 16).
27, rue des Jardins Saint-Paul, source : mariage en 1913, occupé par la mère de Schabsé en 1936.
7 et 9 rue des Jardins Saint-Paul 75004 Paris années 20 et 30 ; commerce de Schabsé et logements, sources : faillites des archives de la mairie de Paris et fichier Brisson, BMOVP 22/08/1942.
Le fonds 1900 W1 257 des Archives de Paris rassemble les dossiers d’expropriation et de d’administration des 7 et 9 rue des Jardins Saint-Paul.
Il est contenu dans un carton qui va reprendre différents numéros : 5, 7 et 9, 11, 13, rue des Jardins Saint-Paul, et 16, rue de l’Ave Maria, cela correspond à l’opération 6B de l’îlot 16.
14, rue des Jardins Saint-Paul années 20, logement source : recensement
43, rue d’Angoulême 75011 Paris (Aujourd’hui rue Jean Pierre Timbaud), années 20 et immédiate après guerre, logement source : recensement 1926 et 1932, 1936. Le recensement de 1946 n’est pas disponible en ligne pour ce quartier.
18, rue de Rivoli 75004, 2e étage, logement de la famille source : recensements 1926 et 1932 et presse, plus de traces de la famille en 1946.
7, rue Charlemagne 75004 (angle 28, rue des Jardins Saint-Paul) : une boucherie achetée par Regina le 26/09/1927 à la famille maternelle de Schabsé, source : archives de la ville de Paris. En 1946, la boucherie appartient à monsieur KISICLEWOSKI.
7, boulevard Saint-Germain : Régina y est recensée en 1936 avec Manousse Pessine.
75, boulevard Saint-Antoine (Regina y est référencée dans l’archive d’expropriation de l’îlot 16 en 1943).
Biens immobiliers pour lesquels la spoliation ou l’aryanisation est avérée :
7 et 9 rue des Jardins Saint-Paul : réquisition et expropriation (îlot 16)
12, rue du Moulin de la Pointe à Paris (13e) (vendu par l’administrateur de l’entreprise en 1944 à Joseph Birolo, le répondant de Raymonde) mais le recensement de 1946 ne trouve pas trace des Fanchel.
Biens immobiliers pour lesquels on sait qu’il n’y a pas eu de spoliation :
Le domicile du 09, avenue Allary à Limeil-Brévannes (94450) a été vendu par Berthe Odette Fanchel, qui s’est ensuite installée à Villecresnes.
Bien “perdu”
Terrains du Parc de Brévannes acheté par Régina en 1930, folio 1187 du cadastre des propriétés non bâties parcelle 410 (?), comprenant respectivement 3 ares et 36 ares, en sol et cour et jardin d’agrément. Le cadastre ne mentionne pas de nouveau propriétaire après 1935 et le nom de Regina n’est pas barré.
Biens mobiliers :
Ce que contenaient les appartements et immeubles mentionnés ci-dessus dont on n’a pas d’inventaire à l’exception des articles mentionnant le cambriolage de la Rue de Rivoli.
Liquidités :
La somme de 1695 francs confisquée à Drancy à Schbasé (cf dossier de Caen).
La somme de 1600 francs confisquée à Drancy à Régina qui a par la suité été versée à la caisse des dépôts (Source : Archives de la Préfecture de police de Paris).
Sources consultées :
- Archives municipales de Limeil-Brévannes
- Archives des pères de Notre Dame de Sion
- Archives de Paris
- Archives de la préfecture de police de Paris (le Pré Saint-Gervais)
- Archives nationales de Pierrefitte
- Archives départementales des Yvelines
- Archives départementales du Val de Marne
- Archives du mémorial de la Shoah
- Archives du SHD Caen
- Bases de données généalogiques européennes, russes et américaines
- Manifestes des Transatlantiques
FONDS 1900 W1 247
Source : MA Deweerdt
Cette pochette est la numéro 137 qui contient les documents relatifs au 7 et 9, rue des Jardins Saint-Paul.
Cette pochette explique en partie que certains documents n’ont pas pu être retrouvés précédemment.
Elle contient des fonds d’archives qui ont dû être retirés de différents dossiers pour être rassemblés dans celui-ci appelé “Succession Kwartler” qui traite de la résolution de l’indemnisation liée à l’expropriation des 7 et 9, rue des Jardins Saint-Paul de 1942.
Source : Archives Municipales de la ville de Paris
En effet, ce carton contient l’acte de vente de l’immeuble ainsi que son historique, l’acte de notoriété établi au moment du décès de Rosa Kwartler-Fanchel, en 1941, mais également différents documents notariés relatifs à la séparation de biens et au divorce des deux époux : Rosa va conserver le bénéfice de l’immeuble à l’issue de la séparation de biens avec Schabsé en 1924, puis leur divorce en 1929.
On trouve dans ce carton des projets établis pour tous les actes ainsi que la copie de l’acte définitif, établi en plusieurs exemplaires.
Il est proposé à chaque locataire qu’il soit un locataire d’appartement ou de local commercial avant l’expropriation un montant d’indemnisation.
Le montant d’indemnisation qui a été proposé à Rosa semble faible eu égard à la valeur de l’immeuble et surtout aux revenus réguliers générés par les loyers. Ce montant est réévalué en 1944. A la mort de Rosa, ses héritiers selon la loi polonaise sont sa fille Regina Kwartler et Manousse Pessine, qui s’avère être son compagnon, pour moitié chacun.
Source : Archives Municipales de la ville de Paris
Après la fin de la guerre, lorsqu’il est presque certain que ni Regina ni Manousse, héritiers de Rosa, ne reviendront, après que le gouvernement aie longtemps tempéré, en disant que, pour l’instant, ces personnes sont portés disparues et donc pas forcément décédées ; une bataille juridique est menée par Berthe Odette Fanchel dans ce dossier.
Rosa a contracté des dettes et hypothéqué plusieurs fois l’immeuble pour pouvoir le conserver. Il faut donc rembourser les sommes empruntées et on trouve des échanges entre le Crédit foncier, la caisse des dépôts et le bureau de l’aménagement des îlots insalubres (Préfecture de Paris), pour régler une situation qui semble “insoluble”. La pièce la plus récente du dossier est un courrier en date du 6 avril 1949 bureau de l’aménagement des îlots insalubres (Préfecture de Paris) disant que le Crédit Foncier peut obtenir le remboursement de l’hypothèque de Rosa auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le travail à mener sur ce fonds a été de dater et de nommer chaque courrier puis de les retranscrire, pour cela, plus de 400 clichés ont été pris pour numériser intégralement le dossier. Les plans exacts de l’immeuble, des boutiques, les montants des loyers, les dates des baux y sont consignés.
On voit aussi qu’après la guerre, la situation est administrativement très difficile pour de nombreuses familles.
Contenu du dossier :
Les documents sont contenus dans une chemise intitulée “succession Kwartler”
Le numéro de l’immeuble sur le plan est indiqué numéro 137 ainsi que l’opération 6B et l’adresse de l’immeuble. Il est indiqué que le dossier est terminé. Le notaire chargé des intérêts de la famille est maître Bachelez, puis maître Fouan, 3, rue de Turbigo à Paris. Monsieur Laville, gérant, estime le bénéfice mensuel des loyers à 32 015 francs fin 1941.
Les courriers ont été retranscrits du plus récent au plus ancien.
Dossier succession, puis second ensemble de documents rassemblé sous l’appellation correspondance mais les documents sont mélangés et mal classés. Ils ont donc été remis dans l’ordre
- Un premier document en très mauvais état et partiellement, détruit, reprend l’historique :
Le 30 avril 1942, un état estimatif, donne une valeur de l’immeuble à 138 000 francs qui, par la suite, est portée à 310 000 francs.
Le 20 mai 1942, la famille est bénéficiaire d’un premier montant de 51 000 francs, par consignation du 15/06/42, mandant 42704 réception 9287, mais elle n’a pas touché ce montant.
Il y a eu une réévaluation de la valeur de l’immeuble le 8 juillet 1943, pour la porter à 560 000 francs, selon la page 28, numéro 118 de la décision.
L’administrateur provisoire est Monsieur Belot, 8 rue Jean Nicot à Paris.
Les successeurs de Rosa sont Manousse Pessine et Regina Kwartler.
Il est indiqué que les ayants droits sont disparus sans laisser d’adresse qu’il est impossible d’établir d’état civil, ni l’origine trentenaire de l’immeuble et qu’on ne peut donc que consigner la somme.
Par ailleurs, une lettre du 24 juillet 1941 du Crédit foncier précise que trois prêts hypothécaires ont été consentis à Rosa pour 47 000, 54 000 et 28000 francs. - On trouve par la suite un document de la direction des services d’architecture et d’urbanisme de la préfecture de la Seine, du service comptabilité, qui est un bordereau des dépenses liquides hors budget pour l’exercice 1942, il reprend la somme de 51 000 francs. Un mandat de paiement de 51 000 francs, au profit de la succession de Madame Rosa Kwartler daté du 17 juin 1942.
- Un second bordereau des dépenses hors budget, daté du 22 avril 1944, signé par le sous-chef du bureau d’aménagement des îlots insalubres précise que les ayants droit de Rosa doivent toucher 560 000 francs comme indemnité définitive de dépossession de son immeuble. On peut déduire un acompte de 51 000 francs, le reste dû est de 509 000 francs avec des intérêts et taxes, ce qui donne un montant final de 548 901 francs.
Un bulletin d’émission de mandat de paiement du budget national de l’exercice 1944 sous le numéro 36189 d’un montant de 548 901 francs au profit des ayant droit de Rosa.
1949
Un document du bureau de l’aménagement des îlots insalubres, daté du 6 avril 1949.
Ce document explique que le Crédit foncier de France a demandé que le règlement de sa créance soit effectué à titre provisionnel pour un montant de 172 320 francs.
Le préfet arrête que la caisse des dépôts et consignations est la seule qualifiée pour procéder au versement, elle est autorisée à verser à titre provisionnel au crédit foncier de France, la somme de 172 320 francs représentant la créance en capital avec les intérêts. Le directeur des services d’architecture et d’urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Un courrier en date du 6 avril 1949, adressé par le bureau de l’aménagement des îlots insalubres au directeur général de la caisse des dépôts et consignation, lui adressant une copie certifiée, conforme de l’arrêté préfectoral en date du 1er avril 1949, autorisant le retrait au profit du Crédit foncier de France de la somme de 172 520 francs, montant du remboursement de la dette de Rosa.
Un État sur transcription du bureau des hypothèques en date du 31 août 1942, qui reprend les précédents propriétaires de l’immeuble, les différents prêts accordés à Rosa par le bureau, avec leur durée et les taux d’intérêts.
Un Courrier manuscrit du 1er avril 1949, adressé par le bureau de l’aménagement des îlots insalubres à Monsieur le gouverneur du crédit foncier de France, au service du contentieux général, qui avoir l’honneur d’avoir soumis à la signature de Monsieur le préfet, une autorisation de la caisse de dépôt et consignation à régler à titre provisionnel, la somme de 172 320 francs, montant de la créance sur la succession.
Un courrier du crédit foncier de France, adressé au préfet en date du 16 mars 1949, qui affirme qu’en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu, ainsi que tout acquéreur, de verser le montant de sa créance à titre provisionnel.
Signé du chef de service, monsieur Gauthey
Une note manuscrite de Monsieur Hélie sur l’affaire Kwartler.
La caisse des dépôts et consignations a été avisée des prétentions du crédit foncier concernant le règlement de l’affaire et tendant à ce que le montant du prêt consenti par cette société à Mme K, soit réglé directement par la ville de Paris, conformément à la législation spéciale dont il bénéficie. La caisse des dépôts répond que la somme ayant été consignée, c’est à elle seule qu’il appartient de procéder au versement des fonds consignés. Au surplus, par lettre du 16 février 1949, la caisse des dépôts a avisé le Crédit foncier, mais à ce jour, 7 mars 1949, le Crédit foncier n’a pas encore répondu, Paris le 7 mars 49.
Un courrier dactylographié en date du 18 février 1949, adressé par le cabinet du directeur adjoint du préfet à Monsieur Degrelle.
Monsieur le directeur m’a remis la fiche que vous trouverez ci-joint, et où il est question d’une visite qu’il a reçue de Monsieur Barbot du contentieux du Crédit foncier de France. Il s’agirait pour le crédit foncier d’obtenir le paiement direct d’une indemnité qui est dûe à un certain K et qui, ayant négligé, ou étant, dans l’impossibilité de fournir des renseignements pour l’attribution de son indemnité, aurait vu l’indemnité consignée à la Caisse des dépôts et des consignations. Le crédit foncier fait valoir l’article 38 du décret du 28 février 1852, et l’article sept de la loi du 10 juin 1853, qui permettrait paraît-il le versement direct des fonds au Crédit foncier de France sans le concours des intérêts. Voulez-vous examiner cette question de principe d’accord avec mademoiselle Delaporte, mademoiselle Gourliau et me renseigner en toute urgence.
Mr Deneux
- Une note manuscrite au crayon, renvoie vers Mr Hélie
- Note manuscrite de monsieur Hélie du 22 février 1949 corrigée par mademoiselle Gourliau en vert
- Brouillon de courrier du 8 février 1949 en réponse à une lettre du 17 décembre 1948 destinée au Contentieux qui doit se mettre en rapport avec la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir le remboursement
Le courrier du bureau de l’aménagement des îlots insalubres, au gouverneur du crédit foncier de France à la suite de la visite de Monsieur Barbot (Février 49)
J’ai l’honneur de vous faire connaître que mes services reconnaissent le bien-fondé de votre argumentation juridique en matière d’attribution directe à votre groupement d’une partie de l’indemnité d’expropriation du aux consorts, si toutefois, l’existence des prêts qui a consenti à ces derniers avait été révélé à mon administration, entendu utile.
Ce courrier renvoie dos à dos la caisse des dépôts et consignation et le Crédit foncier.
Le signataire précise que « l’action de mes services est donc terminée en la matière. J’ajoute que Maître Fouan, Notaire, engagé de la défense des intérêts des héritiers, a toute possibilité d’éclaircir la situation présente en faisant nommer un curateur à la succession vacante. Mais cette désignation ne présenterait même aucun intérêt pour votre organisme, puisque le but de son privilège et d’obtenir un règlement de ces prêts, sans le concours des débiteurs.”
Monsieur Eyraud
Le projet de rédaction et le document final (Janvier 1949) de la direction des services d’architecture et d’urbanisme, sous direction du plan d’aménagement de Paris et de la banlieue parisienne du service d’aménagement de la zone de l’îlot insalubre, section expropriation qui concerne l’opération 6B de l’oc, 16, numéro 137 sur le plan rédigé par Mr. Helie pour le préfet de la Seine.
Ce document précise que la somme de 560 000 francs a été versée à la caisse des dépôts et consignations le 16 juin 1944.
Suit le document dactylographié :
Vu les arrêtés des 15 juin 1942 et 23 mars 1944, prescrivant la consignation pour défaut de justification, la première d’une somme de 51 000 francs montant de l’indemnité provisionnelle fixée au profit des ayant droit de madame Rosa K et la seconde d’une somme de 509 000 francs représentant le solde de l’indemnité définitive, fixé au profit des mêmes pour dépossession d’un immeuble réquisitionné par arrêté du 30 avril 1942 à Paris, figure sous le numéro 137 du plan parcellaire pour 560 000 francs.
Attendu que la somme a été versée à la date des dépôts et consignation à concurrence de 51 000 francs le 16 juin 1942 et 509 000 francs le 16 juin 1944. Vu l’origine de la propriété ci-jointe de laquelle il ressort que l’immeuble dont il s’agit appartenait, conjointement et indivisiblement à Madame Kwartler et Monsieur Pessine.
Considérant qu’ils ont été déportés et présumés décédés
Considérant que la propriété est régulière et qu’il n’y a plus d’obstacle à l’attribution des indemnités provisionnelles et définitives
Vu l’état livré le 27 septembre 1948 par le conservateur du premier bureau des hypothèques de la Seine, constatant l’existence de quatre inscriptions prises, audit bureau :
- 1ere 28 août 1930 Crédit Foncier de France
- 2e 18 février 1932 Crédit Foncier de France
- 3e 12 juin 1934 veuve Camus
- 4e 22 novembre 1939 Crédit Foncier de France
Considérant que ces diverses inscriptions font momentanément obstacle au paiement sans réserve de ladite somme, au vu de l’article neuf de la loi du 1er mars 1942, sur la proposition du directeur des services, d’architecture et d’urbanisme, arrête :
Article premier la somme de 560 000 francs consignée comme il est dit ci-dessus ainsi que les intérêts courus jusqu’au jour du retrait est attribuée aux ayants droit et leur sera payée par Monsieur le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Article deux, le paiement de la somme ci-dessus aura lieu soit sur simple quittance administrative au vu des certificats, constatant la radiation des inscriptions énoncées, soit en présence avec le concours des créanciers inscrits qui donneront mainlevée des inscriptions leur profitant.
Article trois copie certifiée, conforme du présent arrêt transmise à Monsieur le directeur général de la caisse, des dépôts et consignation
Fait à Paris le 20 janvier 1949
Un document manuscrit, esquissant un arbre généalogique qui a dû permettre au rédacteur sans doute Mr Hélie, de comprendre les différents liens entre ces personnes.
Il est indiqué que Regina est disparue. Manousse est déporté le 11 09 42 et « pas rentré ».
Source : Archives Municipales de la ville de Paris
1948
Un courrier, daté du 17 décembre 1948, adressé au préfet de la Seine par le Crédit foncier de France, service du contentieux général.
Monsieur le préfet, j’ai l’honneur de vous rappeler notre correspondance concernant l’opération 6 B Numéro 137 et notamment ma lettre du 16 juillet 1948, relative à l’immeuble des 7 et 9, rue des jardins Saint-Paul hypothéqué à la hauteur des prêts consentis par le crédit foncier à Mme K. par la ville de Paris, moyennant une indemnité de 560 000 francs actuellement consignée à la caisse des dépôts. Vos services m’ont fait savoir que la partie de l’indemnité correspondant au montant de nos prêts ne pourrait nous être réglé que lorsque serait connue la dévolution de la succession, et lorsque serait possible la levée d’un état hypothécaire. Le notaire Fouan, ne pouvant actuellement éclaircir la situation. Nous avions demandé le remboursement provisionnel de notre créance conformément à notre législation spéciale. Au cours de ma visite en vos bureaux et de notre entretien du 6 décembre au courant, vous m’aviez informé que vous n’étiez même pas certain du droit de Madame K, expropriée, et que vous accepteriez sans doute d’ordonner notre remboursement provisionnel, si le crédit foncier vous remettait une copie de la partie de son plus récent contrat de prêt, passé le 4 février 1932, relatant l’affectation hypothécaire et l’origine de propriété. Vous voudrez bien, ce pli, trouver la copie certifiée conforme ainsi que les décomptes de nos prêts arrêtés au 31 janvier 1949 et s’estimant à la somme globale de 170 265 Fr.
Je me permets de vous rappeler l’article 38 du décret du 28 février 1852. (Citation de l’article).
La législation spéciale affirme qu’en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’exproprié est tenu ainsi que tout acquéreur, de payer au crédit foncier le montant de sa créance à titre provisionnel.
Aussi, serions-nous en droit de demander au tribunal civil de constater la nullité de la consignation à notre égard et d’ordonner le paiement provisionnel.
Le Crédit foncier demeure en tout état de cause tenu des obligations qu’il a prises pour se procurer des capitaux et les mettre à la disposition des emprunteurs. Aussi est-il de toute nécessité que les sommes exigibles puissent être par lui recouvrées immédiatement. Ce recouvrement présenterait d’ailleurs pour les emprunteurs un avantage puisqu’il mettrait un terme au cours des intérêts de retard dont la créance est productive et qui sont calculés à un taux très supérieur à celui des intérêts résultant de la consignation. Je suis persuadé qu’après un nouvel examen de cette affaire, vous voudrez bien reconnaître le bien-fondé de notre demande et prendre un arrêt de consignation pour permettre notre provisionnel.
Monsieur Gauthey
Une note manuscrite précise qu’un coup de téléphone du 13 janvier 1949 a informé le Crédit foncier de France, que l’arrêté allait être pris pour leur permettre de toucher le montant de leur prêt.
Est joint à ce courrier, un acte notarié, rédigé par Maître Victor BACHELEZ notaire, du prêt de 25 000 francs à Rosa, avec rappel de l’origine de propriété et du contrat de séparation de biens et du divorce.
Une note manuscrite de Gabriel Gauthey, du Crédit foncier de France, atteste de la véracité du contrat de prêt du 4 février 1932.
Suivent trois comptes de remboursement des prêts souscrits par Rosa.
Un courrier du 19 juillet 1948 du Crédit foncier de France au préfet de la Seine. Il accuse réception de sa lettre du 5 juillet 1948 et confirme qu’il attend le règlement de l’indemnité qui n’engage pas la responsabilité de la ville de Paris, ni la caisse des dépôts. Il regrette que la solution amiable préconisée par le crédit foncier n’ait pas été retenue et menace d’une assignation devant le tribunal civil de la Seine.
Un courrier du bureau de l’aménagement des îlots insalubres au gouverneur du Crédit foncier de France, en date du 5 juillet 1948, expliquant que c’est la caisse des dépôts et consignations qui doit payer, rédigé par monsieur Lambert.
Un courrier du Crédit foncier de France, en date du 21 mai 1948, au bureau de l’aménagement des îlots insalubres, qui accuse réception de sa lettre du 14 mai 1948, l’assure que leur société est en rapport constant avec Maître Fouan notaire. Ce courrier note “qu’il n’apparaît pas que ce notaire puisse à brève échéance, dénouer la situation complexe que je vous ai signalé. C’est pourquoi, devant l’impossibilité d’obtenir le remboursement des prêts suivant lés normes habituelles. J’ai cru devoir vous demander par ma lettre du 5 avril, le paiement provisionnel de notre créance”, il espère une résolution amiable de cette situation.
Un courrier tapé de maître Fouan, notaire des Kwartler, qui écrit au bureau d’aménagement des îlots insalubres en date du 20 mai 1948. Monsieur le préfet, en réponse à votre lettre du 14 mai, il ne m’est pas possible de vous donner dans leur totalité les renseignements que vous me demandez. Je peux toutefois vous faire savoir que le divorce des époux a été prononcé en vertu d’un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 15 avril 1929, transcrit en marche de l’acte de mariage le 27 mars 1930, je ne possède aucun renseignement sur Manousse Pessine qui a été déporté et porté disparu je ne connais pas l’État civil de Monsieur Fanchel ni même s’il était naturalisé français.
Un courrier du crédit foncier de France, au préfet de la Seine, en date du 14 mai 1948,
Monsieur le préfet, par lettre du 5 avril, j’ai eu l’honneur de vous faire connaître que le Crédit Foncier est créancier inscrit sur un immeuble sis à Paris exproprié par la ville de Paris, et ayant appartenu à Madame Rosa K, décédée.
En vous signalant que la dévolution de la succession de notre débitrice était inconnue, je demandais, en invoquant la législation spéciale du crédit foncier, que le remboursement de notre créance soit effectué à titre provisionnel sur le montant de l’indemnité consignée. Je vous serais gré de bien vouloir me faire connaître la suite donnée à cette demande à laquelle aucune réponse n’a été faite jusqu’à ce jour. Formule de politesse.
Le brouillon d’un courrier en date du 14 mai 1948, destiné au Notaire, rédigé par Monsieur Lambert.
Par lettre en date des 14 août et 4 novembre derniers, je vous réclamais des renseignements concernant la succession Kwartler dont l’actif comprend un immeuble exproprié à Paris quatrième. Cet immeuble est grevé d’hypothèques inscrites au profit du crédit foncier. Je suis saisi par le crédit foncier d’une demande de remboursement du montant des créances qui ont été consenties selon la procédure spéciale de recouvrement. Merci de me faire connaître de toute urgence, la date du jugement de divorce des époux, l’état civil complet de Monsieur Pessine, l’état civil complet de Monsieur Fanchel, Monsieur Fanchel était-il naturalisé français ? Et si oui la date du décret de naturalisation.
Formule de politesse à toutes fins utiles, je vous rappelle que Madame Kwartler est décédée à Paris le 5 avril 1941.
Le courrier du 14 mai 1948 de la préfecture au Crédit Foncier de France qui reprend les différents éléments de l’affaire :
- 1942, désignation des ayants droits
- Les ayant droit ont été déportés et n’ont pas reparu, mais Regina laisse plusieurs enfants naturels dont l’aînée, mademoiselle Fanchel, habite Brévannes, 9, avenue Allary. Mademoiselle Fanchel a chargé Maître Fouan, notaire, de ses intérêts. Celui-ci attend d’être en possession des actes de décès de Regina K et Manousse P pour dresser les actes de notoriété et régler la succession. “Nous espérons que dans un délai de trois mois environ, l’indemnité pourra être mise à disposition des héritiers sous réserve de paiement des créanciers hypothécaires. Dans le cas contraire, je serai obligé de considérer l’affaire comme insoluble. De toute façon, et afin d’ éviter les difficultés possibles, je vous tiendrai au courant de la suite donnée par le notaire au règlement de la succession. Par ailleurs, je vous informe que les recherches ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure spéciale de recouvrement qui est à votre disposition puisque le paiement n’est définitif qu’avec le concours de tous les intéressés”. La formule de politesse est rayée.
Un Courrier du Crédit foncier de France en date du 5 avril 1948 au préfet.
Ce courrier rappelle les prêts consentis et les inscriptions prises au bureau des hypothèques et le fait qu’en l’absence d’éléments concernant la succession, le crédit foncier demande l’application des dispositions de sa législation spéciale et le règlement de la créance.
1947
Un courrier manuscrit rédigé par Mr Helie adressé au notaire.
Le 4 novembre 1947, monsieur, je vous rappelle ma lettre du 14 août dernier relative à l’affaire. Indiquer en marge entre parenthèses “succession Kwartler”. Il serait utile et conforme à l’intérêt de vos clients, de recevoir les renseignements que je vous ai demandés pour l’accomplissement des formalités hypothécaires prévues par le décret du 8 avril 1936. Au cas où ma lettre présente ne vous serait pas parvenue, je vous en ai adressé une copie. Formule de politesse.
Un courrier manuscrit du 14 août 1947 de Monsieur le directeur du bureau d’aménagement des îlots insalubres à destination du Notaire. Monsieur, je vous rappelle que j’ai toujours en suspens à mon service, le dossier de la ferme mentionnée en marge entre parenthèses “succession Kwartler”, par suite de la non communication par les ayant droit de leur État civil et de leur droit à l’indemnité, j’ai dû, conformément à l’article 46 du décret du 8 août 1935, prescrire le versement de l’indemnité à la caisse des dépôts et continuation, pour la succession de madame K, par la commission arbitrale d’évaluation de la scène de la somme de 560 000 francs. Je n’ai pu jusqu’à ce jour, remplir les formalités hypothécaires prévues par la loi, mon dossier étant incomplet. Je vous serais par la suite très obligé de vouloir me fournir. Si toutefois, vous en avez la possibilité, les renseignements suivants : la date du jugement du divorce Fanchel, avec notification du tribunal, l’état civil complet de Monsieur Pessine, l’état civil complet de Monsieur Fanchel, Monsieur Fanchel était-il naturalisé français et dans l’affirmative indiquez la date du décret.
Un courrier du ministère des anciens combattants en date du 20 mars 1947, adressé au directeur des services d’architecture et d’urbanisme. En réponse à votre lettre, citée en référence, j’ai l’honneur de vous faire connaître après les documents existants au fichier central, monsieur Pessine a été interné à Drancy, déporté le 11 septembre 1942, et n’a pas été rapatrié à ce jour.
Un courrier du 19 février 1947 adressé au ministère des anciens combattants par la préfecture pour savoir ce qu’il est advenu de Manousse Pessine.
Un courrier de la préfecture en date du 15 février 1947, adressé à Berthe Odette, chez Monsieur Birolo.
Mademoiselle, je vous serais obligé de bien vouloir vous présenter au bureau d’aménagement des îlots insalubre, 98, quai de la Rapée au sixième étage en vue d’un nouvel examen de votre dossier, compte tenu de l’ordonnance du 21 avril 1945, modifié par la loi du 23 décembre 1946.
Suivent plusieurs brouillons de courriers du préfet au Crédit foncier de France, on remarque que ces courriers sont très travaillés, annotés à de multiples reprises avec des couleurs différentes.
1946
Un courrier en date du 9 avril 1946, de Maître Bachelez à destination de la préfecture.
En réponse à votre lettre du 3 février dernier, je vous confirme que d’après les renseignements qui viennent de m’être donnés, Regina K, héritière de Rosa K, serait décédée déportée en Allemagne et représentée par une fille qui habite Paris. D’autre part, Monsieur Pessine, légataire universel de Mme K, a lui-même été déporté et disparu. J’ignore jusqu’à ce jour quels peuvent être ses héritiers et je n’ai pas encore les actes de décès, ni de l’un ni de l’autre. Il m’est donc impossible en ce moment, n’ayant pas de fonds, d’opérer aucun règlement sur les contributions arriérées. Je n’ai d’autre part aucun pouvoir régulier pour suivre le dossier des immeubles du Jardin Saint-Paul. Je sais simplement que la fille de Mademoiselle K me chargera de ses intérêts dès qu’elle aura pu obtenir l’acte de décès de sa mère. Formule de politesse.
– Deux notes manuscrites de monsieur Hélie de l’année 1946 :
- Une note du 2 avril 46 qui reprend l’historique et rappelle que Berthe Odette, hérite comme fille aînée. Elle travaille chez monsieur Birolo, 72 rue du Château d’Eau. Qu’elle a une jeune sœur mineure. L’auteur de la note a rencontré monsieur Birolo qui va prévenir Berthe et son notaire. Manousse Pessine ne laisse aucun descendant.
- Une note postérieure mais non datée qui dit que Berthe a été informée de la procédure à suivre pour obtenir une révision de la décision de la CHE. Mme Fanchel, appelée Frankel, n’a rien fait. Monsieur Bachelez est chargé de ses intérêts mais n’a reçu aucune instruction. Le dossier est mis en attente pour attribution et déconsignation, monsieur Bachelez se refusant à dresser l’acte de notoriété sans être en possession des actes de décès. “On pourrait peut être écrire à mademoiselle Fanchel pour lui faire connaître les dispositions légales touchant les actes d’État Civil des disparus. Ce à quoi il est répondu “oui” 10/12.” Monsieur Hélie a œuvré pour que Berthe Odette puisse toucher ce à quoi elle avait droit.
Un courrier manuscrit adressé à Berthe lui demandant de se présenter au bureau des aménagements des îlots insalubres en date du 12 février 1946, rédigé par monsieur Hélie.
Un courrier du notaire en date du 28 janvier 46 à destination de la préfecture qui donne les adresses de Regina et Manousse Pessine.
Un courrier de la préfecture du 22 Janvier 1946 sans doute adressé au notaire expliquant que les services de la préfecture sont toujours en charge du dossier K, que la somme a été déposée à la caisse des dépôts et consignation, et que les justificatifs n’ont pas été fournis par la famille. Il demande, pour pouvoir déconsigner la somme, les adresses de Régina et Manousse Pessine qui sont des renseignements indispensables.
1945
Un courrier en date du 24 août 1945 en réponse au crédit foncier.
En réponse à votre lettre, j’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai bien pris note des trois prêts consentis par le crédit foncier de France à Mme K. Il rappelle le montant de l’indemnité et explique que pour l’instant l’origine de la propriété n’a pas été établie et que la somme a été versée à la caisse des dépôts et consignation. Quand les pièces justificatives auront été fournies, un arrêté de déconsignation sera pris.
Un Courrier du Crédit foncier de France, au préfet de la Seine, en date du 24 juillet 1945, ce courrier rappelle les trois prêts 1898, 1930, 1932. Le rédacteur explique que d’après les renseignements recueillis, l’immeuble a fait l’objet d’une expropriation par la ville de Paris. Il demande donc confirmation des indications et qu’on lui fasse connaître l’état actuel de cette affaire pour règlement.
1944
Un projet d’arrêté du 23 Mars 1944
Un courrier du 29 février 1944, adressé à la préfecture par Monsieur Belot.
Monsieur, je vous accuse réception de votre courrier concernant l’affaire cité en marge et me demandant l’état civil de Monsieur P. Monsieur Bachelez, Notaire, chargé de cette affaire à qui j’ai réclamé cette pièce, me confirme qu’il ne possède aucun autre renseignement que ceux fournis dans l’inventaire.
Un courrier du 22 février 44 adressé à Monsieur Belot par le bureau d’aménagement des îlots insalubres.
Afin de me permettre de vous payer l’indemnité due à Monsieur P et Madame K, juifs, pour dépossession de l’immeuble de la rue des jardins Saint-Paul, dont vous avez été nommé administrateur provisoire, je vous serais obligé de bien vouloir me faire parvenir à l’adresse ci-contre les renseignements d’État civil concernant Monsieur P. Faute de recevoir pour fin février, les renseignements ci-dessus demandés, je me verrais dans l’obligation de verser l’ indemnité à la caisse des dépôts et consignations.
Un courrier en date du 18 janvier 1944 du notaire à Monsieur Belot.
En réponse à votre lettre du 11. Je vous adresse un extrait de l’intitulé d’inventaire après le décès de madame K. Il n’a pas été fait d’acte de notoriété. J’ignore si Monsieur F est décédé, il n’est pas client de l’étude et n’est pas partie intéressée dans cette affaire puisque l’immeuble a été attribué à Madame K. seule. Je ne possède aucun renseignement sur Monsieur P, je suis surpris qu’il soit question de consigner purement et simplement l’indemnité d’expropriation sans tenir compte de la situation des créanciers inscrits sur l’immeuble.
Un courrier en date du 11 janvier 1944 du bureau d’aménagement des îlots insalubres à l’ l’administrateur
Afin de me permettre d’établir l’origine de la propriété de l’immeuble appartenant aux ayant droit de Mme K. Je vous serais obligé de m’envoyer les actes de notoriété à la suite des décès de Monsieur F et de Madame K ainsi que les état civil complet des héritiers, Monsieur P, Madame K, Date et lieu de naissance, date et lieu de mariage. Si il y a lieu contrat de régime matrimonial adopté. Faute d’avoir reçu pour la fin du mois, les renseignements ci-dessus demandés je serai dans l’obligation de verser à la caisse des dépôts et consignations le montant de l’indemnité d’expropriation.
1943
Un courrier du 14 décembre 1943, de Maître Bachelez à Mr Belot de Viset
Monsieur, en réponse à votre lettre du six, et comme suite à votre demande, je vous adresse un extrait de l’intitulé d’inventaire dressé après le décès de Madame K. Il précise que les époux F sont divorcés et qu’il y avait une séparation de biens entre les époux F.
Un courrier du 11 novembre 1943, de Maître Bachelez à Mr Belot de Viset
Il communique une copie de l’acte de vente et indique que l’immeuble est actuellement en indivision entre Monsieur Pessine et Madame Kwartler.
Par ailleurs, il précise que l’immeuble est hypothéqué et une des hypothèques au profit d’une cliente de l’étude.
1942
Un courrier manuscrit en date du 15 juin 1942, adressé à Monsieur Belot, administrateur provisoire par la préfecture qu’il informe que l’indemnité allouée pour expropriation a été consignée à la caisse des dépôts pour défaut de justification.
L’arrêté du 15 juin 1942, émis par Mr Deneux
Un document du commissariat général aux questions juives du 6 avril 1942, qui désigne Monsieur Belot administrateur provisoire et Monsieur Pessine, propriétaire de l’immeuble.
Une troisième chemise reprend les arrêtés :
Arrêté du 15 juin 1942, attribution d’une somme de 51 000 francs
Arrêté du 23 mars 1944 qui fixe l’indemnité à 560 000 francs, l’administrateur provisoire est Mr Belot, 4 rue Arsène Houssaye Paris 8
Une chemise préfecture rassemblant :
- un courrier de la préfecture de la Seine du 24 septembre 1948, adressée au bureau des hypothèques qui demande un état concernant les inscriptions de toute nature.
- un état notarié des précédents propriétaires de l’immeuble et l’attestation que lors de l’expropriation, l’immeuble appartenait conjointement et indivisiblement à Regina et Manousse.
Une autre sous chemise correspondances :
- L’acte de notoriété de Rosa appelé inventaire
- L’état liquidatif de la communauté Fanchel
Acte de vente de l’immeuble
- original de l’acte de vente
Etat des locataires de l’immeuble
- Des estimations de la valeur de l’immeuble à diverses dates
- Des courriers de la préfecture au bureau des hypothèques
- L’état des propriétés trentenaire
- Les copies des décisions de la commission de réception des expropriés
- Le mémoire en réponse de la commission arbitrale de décision des indemnités
- Une estimation foncière
- Une description des bâtiments
- L’estimation du revenu généré par la location
- La liste des locataires
35 Locataires verbaux en 1942
Source : Archives Municipales de la ville de Paris
1- André Collard Concierge RDC
Escalier A
2- Michel Sawon, terrassier, a deux enfants à charge de 4 et 14 ans plus sa femme. Il est entré en location en avril 1939.
3- Cheld Cukiermann, brocanteur, vit dans l’immeuble depuis 8 ans et 9 mois, (1933), 6 enfants à charge entre 4 et 14 ans et sa femme. Il ne peut plus travailler car il est israélite.
Il a été convoqué deux fois et ne s’est jamais présenté selon une note manuscrite dans son dossier.
En effet, Cheld a été déporté par le convoi 13, sa femme Chaya a été déportée par le convoi 24, les enfants Eva, Paulette, Isaraël Léon, Berthe, Victor, Joseph par le convoi 24. Aucun n’a survécu.
4- Cunégonde Bibulska (déportée, note manuscrite dans son dossier)
5- Madame Rachel Golter, ménagère, est veuve, elle habite un deux-pièces depuis 23 ans, avec à sa charge, un parent âgé.
6- Louise Trinquet (absente) elle est restée cinq ans et neuf mois dans le logement. Elle était au chômage. Mention “décédée sans laisser de famille”.
7- Angèle Joannestest (veuve d’Arthur) ménagère, elle habite un petit appartement depuis un an et trois mois avec elle est âgée de 72 ans et souffre de rhumatismes.
8- Louis Queyrat est maroquinier, il vit dans l’immeuble depuis 63 ans (1879), il y est né. Il a à sa charge un enfant mineur de 20 ans et un frère. Il est paralysé d’une main. Il ne voit presque plus. Sa femme est décédée, il ne peut plus travailler.
9- Joseph Mordka, charpentier, a une femme et une fille de 14 ans. Il est invalide de guerre. Sa femme et femme de ménage. Il a emménagé en 1941.
10- Léon Berencwaig
Il n’y a aucun renseignement sur lui dans les dossiers. Selon le Mémorial de la Shoah, né en 1895, il a été déporté par le convoi 7, il n’a pas survécu. Au mémorial de la Shoah, on trouve une photo de lui où est inscrite : Léon, père de Pauline, 1940.
11- Madame La Galla a quitté son domicile en 1941 sans laisser d’adresse. Son époux Angelo a été mobilisé et s’est présenté à la caserne avec ses deux jeunes enfants…
12- David Nainchrik, brocanteur, a emménagé depuis trois ans et six mois. Il a à sa charge un enfant de quatre mois. Ainsi que sa femme. Apparemment, il ne peut plus travailler.
13- Léontine Etey mécanicienne Son mari est hospitalisé militaire comme grand malade. Ils ont emménagé en 1930. Rapatrié d’Allemagne, où il était prisonnier de guerre. Il est hospitalisé au sanatorium de l’hôtel du Mont-Blanc à Passy en Haute-Savoie.
14- Germaine Chubert busquetière (fabrique les pièces d’acier des corsets). Germaine a deux personnes à charge qui sont son neveu et sa nièce, orphelins. Ils ont sept et 10 ans. Elle est arrivée dans l’immeuble en 1900.
15- Émilie Teyssedre elle est arrivée dans l’immeuble en 1926 et s’est réfugiée dans le Gard en zone non occupée. C’est son neveu qui s’occupe des démarches pour elle. Elle a à sa charge sa mère âgée.
16- Monsieur Muller : son logement est occupé par monsieur David Nainchrik
17- Aron Aronowitz a été déporté par le convoi 9. On ne sait rien de plus.
18- Veuve Gayaud marchande de quatre saisons, elle occupe le logement depuis 31 ans. Elle travaille rue Saint-Antoine comme marchande des quatre saisons.
19- Émile Leroux est arrivé en 1939, il travaille aux Halles et occupe une pièce au 6e sur cour.
20- Camille Pierre : grainetier, il est arrivé dans l’immeuble en 1924
21- Fernand Douminjou occupe une chambre sous les toits depuis 1924. Âgé de 59 ans, il a été réformé numéro deux sans pension.
Escalier B
22- Madame Baucher décédée.
23- Léon Hania porteur aux Halles Léon est porteur aux Halles et sa femme est marchande des quatre saisons. Ils sont arrivés en 1925.
24- Rachel Guirchowitz veuve de Kadisch, Rachel vit dans l’immeuble depuis 28 ans. Elle a 61 ans, elle est secourue par une œuvre de Bienfaisance du 4e arrondissement.
Source mémorial de la Shoah : Rachel Guirchowitz est née le 18/01/1881 à Friedrichstadt (Allemagne). Elle est réfugiée russe. Elle est la fille d’Henri Guirchowitz et Ita née Becker. Elle est sans profession, célibataire et a un enfant. Elle est internée au camp de Drancy (Seine-Saint-Denis) le 06/01/1943 et prévue pour être déportée le 11/02/1943. Elle meurt en gare du Bourget au moment du départ du convoi 47.
25- Manousse Pessine, casquettier, est arrivé seul dans l’immeuble en 1935. Il a son logement et un atelier. Il est déporté par le convoi 31 à destination d’Auschwitz. C’est le compagnon de Rosa. Et son légataire avec Régina.
26- Jean Lebreaud, manœuvre, ne paie pas son loyer entré dans l’immeuble en 1923, il a sa charge d’une fille de 14 ans. Il a été mobilisé.
27- Chulim Goldmann est cordonnier : il s’est engagé dans la légion étrangère. Sa femme était couturière, mais ne travaille plus. Ils ont trois enfants : un fils de cinq ans et deux filles de trois et 11 ans. Ils sont arrivés en 1935.
28- Léon Palevodi est arrivé dans l’immeuble en 1904 il ne travaille plus en raison de son âge.
29- Simon Gomolinski, coiffeur, arrivé dans l’immeuble en 1935, il a deux filles de 12 et 14 ans. Sa femme est fourreuse.
30- Ryca Haimovici, 73 ans, vit seule, sa petite fille signe sur le document, “j’accepte pour ma grand-mère”. Elle est veuve et vit dans l’immeuble depuis 1922.
31- Haimu Leibovice, manœuvre, est interné dans un camp car israélite. Sa femme est restée au domicile avec quatre enfants. Trois fils de 10, 11 et 17 ans, une fille de 13 ans. Ils sont arrivés en 1937.
Voici un extrait de sa biographie publiée sur le site du Convoi 77 : “Il est né en Roumanie. Il était marié avec Freida. Il a été déporté avec deux de ses fils : Marcel et Gaston par le convoi, 77. Son fils Samuel a été déporté par le convoi 53 parti de Drancy, le 28 mars 1943. Seules sa femme et sa fille Berthe échappent à la déportation”.
32- Jean Trzebestowski vit dans l’immeuble depuis 1937.
Escalier C
33- Chenia Okon, ouvrier boulanger, est arrivé en 1934.
34- Abraham Grossmann, terrassier, est en maladie et ne peut plus travailler. Il vit avec sa femme et a deux enfants d’un premier mariage. Il est arrivé dans l’immeuble en 1908.
35- Léon Levinshot sans adresse connue c’est sa fille madame Mouilard qui signe (indique que son père est juif).
Locataires à bail
- Francisco Iglesias, brocanteur et son épouse Pauline Poilve sont dédommagés pour leur commerce du rez-de-chaussée à hauteur de 40 000 francs.
- Société WENGER boulangerie
- Gronner, chiffonnier au RDC, serait dans un camp de concentration (Gaston Saddiev, commissaire gérant accepte l’indemnité). On remarque qu’en 1942, à Paris, le terme camp de concentration est utilisé par l’administration.Selon le Mémorial de la Shoah : Maurice (Mendel) Gronner est né le 01/05/1892 à Kowno (Lituanie). Il est l’époux de Oudesse née Semiatiszky. Ils ont deux enfants, Jacques et Suzy. Il est arrêté avec son fils le 12/12/1941 à leur domicile. Ils sont internés au camp de Compiègne. Tous deux sont déportés par le convoi 1 parti du camp de Compiègne le 27/03/1942 à destination du camp d’Auschwitz. Ils ne sont pas revenus de déportation.
Le 28 mars 1942, Mendel et ses deux enfants sont dénaturalisés, victimes des lois Vichystes[21].
Source : Archives Nationales de Pierrefitte
Sa fille Suzy touche 14 000 francs.
Analyse :
L’immeuble rassemble une population majoritairement juive, d’Europe de l’Est. Pour certains cas, l’indemnité a pu être négociée avant la déportation par exemple pour Manousse Pessine.
Dans d’autres cas, en 1942, certains appartements sont déjà vides et on ne retrouve pas les personnes.
Elles peuvent être soit réfugiés en zone libre, comme on a vu le cas d’Emilie, soit internées en camp de travail comme le cas de Haimu, soit tout bonnement et simplement disparues. Pour beaucoup, ils occupent les lieux depuis très longtemps. On remarque aussi qu’ils ont des situations sociales difficiles : invalidité, blessures de guerre, veuves… Ils peuvent avoir des parents âgés à charge.
Au-delà du destin tragique des Fanchel, on ne peut qu’être bouleversé par la lecture de la minutie de l’administration. En effet, les documents projet et les documents finaux comprennent de très nombreux détails sur les personnes.
Ces familles ont également été victimes.
Notes & références
[1] En demandant à une IA de faire la biographie de Schabsé et celle de Rosa, son épouse, puis de Regina, sa compagne, nous avons eu accès à des fonds d’archives nouveaux. A ce titre, même si les conclusions de l’IA sont souvent très approximatives, les sources auxquelles elle nous donne accès et qu’elle mentionne sont d’une aide précieuse.
[2]Une des hypothèses de départ du travail mené sur Nathan Potzeha et sa femme Régina était de savoir s’ils connaissaient les autres familles juives de Brévannes. De nombreux juifs sont internés au sanatorium de Brévannes et subiront également la déportation (par le convoi 63).
[3] Anna Tokar est née à Schornmans qui appartenait à la zone de résidence juive de l’Empire russe.
[4] Les archives de la Société de secours mutuels des Israélites russes (Bibliothèque historique de Paris) mentionnent une « A. Tokar » comme donatrice régulière entre 1895 et 1910, révélant son implication dans les solidarités transnationales. Son nom apparaît également dans les registres de la synagogue de la rue des Tournelles (ACIP, cote ACIP-1890-12), attestant dʼune pratique religieuse active.
[5] The National Archives in Washington, DC; Washington, DC, USA; Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957; Nº de microfilm ou NAID: T715; Titre du groupe d’archives (RG): Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004; RG: 85
[6] Cette partie de la recherche a été particulièrement intéressante car l’étude des manifestes de transatlantiques, même si certains sont très difficiles à lire, apporte de très nombreuses informations sur la situation financière, la profession, le dernier lieu de résidence, l’aspect physique et également les stratégies migratoires : chez les cousins, les frères, les soeurs… C’est une source extrêmement précieuse.
[7] Affirmation non présente dans son ouvrage
[8]D’autres membres de la famille paternelle de Schabsé sont enterrés à Bagneux, les Tokar.
[9] BRONSTEIN Robert décédé en 1926 / KRITCHEWISKY Eugénie décédée en 1926 / Slata SAXE épouse LOURIE décédée en 1926 / Dora KULIK décédée en 1926 / Rosa GROPEGUE décédée en 1925 / Rachel MORDSKY épouse TOKARSKY décédée en 1925 / Haya PADLOUM épouse GRINBERG décédée en 1926 / Rachel WEIZER décédée en 1926 / Rebecca GRINBLAT épouse WEIZER décédée en 1925 / Louba GOROCH épouse KOURORIEZ décédée en 1926 / Tema ZEFTMAN épouse ARENSTEIN décédée en 1926 / Wolff BERNSTEIN décédé au champ d’honneur le 4 septembre 1918 à l’âge de 32 ans / Israël POLICHOUK décédé le 4 octobre 1929 à l’âge de 35 ans / Haim Hersch BORNSTEIN décédé le 3 septembre 1925 à l’âge de 33 ans / Salomon JANICHEWSKI décédé le 9 juillet 1924 à l’âge de 35 ans / Michel KAUFFMANN décédé le 20 novembre 1912 à l’âge de 27 ans / Israël BAKALTCHUK décédé le 9 octobre 1924 à l’âge de 4 ans / Philippe BAZOFSKI décédé le 10 septembre 1923 à l’âge de 54 ans / Joseph WEIZER décédé le 14 septembre 1925 / Samuel SUROVITCH décédé le 21 octobre 1925 à l’âge de 18 ans /Abraham BOBROFF décédé le 13 mars 1925 à l’âge de 35 ans
[10] L’orthographe du prénom sur le caveau est Chana Fanchel, née en 1838 décédée en 1940.
[11] Sur ce document, on voit que Regina est recensée au même domicile que Manouss Pessine, né en 1882 à Odessa, réfugié russe, casquettier, déporté par le convoi 31 du 11/09/1942 et gazé à Auschwitz.
[12] Bagneux : 31-12-7
[13] Malgré des recherches dans tous les cimetières parisiens, la tombe de Vincent n’a pas été retrouvée. En pratique, au début du XXe siècle, l’inhumation d’un enfant de trois jours était prise en charge par la Hevra Kadisha. L’enfant était déposé dans la tombe d’une personne inhumée ce jour-là.
[14] Dossier demandé en novembre 2024.
[15] Guy Lassalle, féru d’histoire, est passé au collège pour me dire qu’il avait des renseignements à me donner sur les Fanchel.
[16] Joseph Klaiman et Pessa Rappoport ont été déportés par le Convoi 46, ce sont les parents d’Estera Klaiman épouse Tokar.
[17] Correspondance du 24/09/1942 au 25/06/1943 échangée entre Léo Israelowicz de l’Union générale des israélites de France, zone nord, et Monsieur J. François, directeur des affaires administratives de la police générale de Paris, au sujet des demandes de libération de détenus internés à Drancy CDXXIV-44 P 120 Titre : Fonds de l’Union générale des Israélites de France (UGIF) – instrument de recherche général / Auteur : Israelowicz, Léo Période : 24 septembre 1942-25 juin 1943 Description physique : 157 pièces Langue : Français Origine : Israelowicz, Léo Résumé : Les ordres de libération, auxquels font référence les lettres de Léo Israelowicz, sont signés par Messieurs Röthke, Ahnert et Heinrichsohn Conditions d’utilisation : Mention obligatoire : Mémorial de la Shoah. Pas d’utilisation sans autorisation préalable Lieu : FRANCE
[18] Les archives des Pères de Sion : Les dossiers mentionnés par le Mémorial de la Shoah sont bien conservés chez les Pères mais il n’y a pas de dossier relatif à Raymonde Fanchel (questionnaire/réponse).
[19] Ensemble de documents, datés de la fin de la seconde guerre mondiale et de l’après-guerre, consistant en des questionnaires, des photographies et des lettres, remplis et adressés à l’ordre de l’institution Notre-Dame-de-Sion par des parents de personnes déportées en vue d’obtenir des renseignements sur ces derniers DI(1-264) DI(100) Titre : Fonds Notre-Dame de Sion Auteur : Schwob, Lise Ameau, Norbert, 3 Meyer, Michel, 3 Période : 13 novembre 1944-18 février 1947 Description physique : 250 pièces Particularité du document : Inscription, Signature, Photographie Langue : Français Résumé : Cet ensemble de documents est principalement constitué de questionnaires remplis grâce aux indications fournies par des parents de personnes déportées et comportant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, dates d’arrestation, dates de déportation, professions et domiciles des déportés, les noms et âges de leurs enfants, les noms et adresses des personnes restantes et à qui communiquer les renseignements. Des photographies des personnes recherchées viennent souvent compléter les questionnaires, ainsi que, plus rarement, des lettres écrites par les proches des déportés. Une généalogie de Monsieur et Madame Raymond et Antoinette Berr, une biographie de Monsieur Raymond Berr, une liste de ses titres et décorations militaires, ainsi que de ses titres scientifiques et de ses publications, une note des établissements Kuhlmann sur l’arrestation de la famille Berr, une lettre de Norbert Ameau, secrétaire du Colonel Rebattet, datée du 09/04/1945, adressée à Monsieur Jean Cerf concernant les recherches ayant été faites pour retrouver le frère de ce dernier, Monsieur Paul Cerf, déporté, trois formulaires de « demande de recherche pour déporté » du ministère des Prisonniers déportés et réfugiés concernant Messieurs Hersz Dreksler et Lévy Goldbroit, cinq fiches d' »affirmation du décés » datées du 18/02/1947 concernant la famille Gattegno (Jean, Letitia et leurs enfants, André et Eliane) et Monsieur Armand Lambert, une carte postale du château d’Habère-Lullin, incendié par les Allemands le 25/12/1943, une lettre datée du 08/03/1944 du Garde des Sceaux et Président du Conseil d’Etat adressée à l’Ambassadeur de France, Délégué Général du Gouvernement pour les territoires occupés demandant des renseignements sur Monsieur Pierre Isidore Lévy, maître des requêtes au Conseil d’Etat et déporté et une fiche du ministère des Prisonniers déportés et réfugiés datée du 20/10/1945 certifiant que leurs services ont délivré un certificat assurant que Monsieur Jankel Lewin a été déporté en Allemagne le 17/07/1942 . – Les dossiers sont classés par ordre alphabétique
[20] Avec prise en compte de la correction de l’inflation.
[21] https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_057227&udId=denat6104&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=true


 English
English Polski
Polski