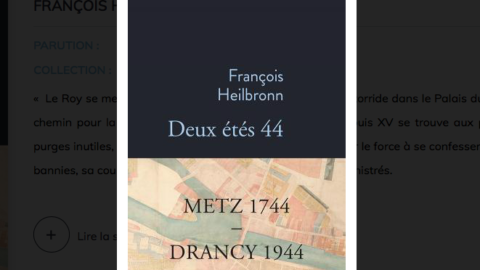Benoît Falaize, historien et membre correspondant du Centre d’histoire de Sciences Po, a co-dirigé avec l’enseignant en histoire-géographie Mohand-Kamel Chabane le livre collectif « Parce que chaque élève compte. Enseigner en quartiers populaires »*, publié en août 2022.
Dans cet ouvrage, les auteurs démontrent qu’il existe des raisons d’être optimistes en mettant en avant le travail réalisé par de nombreux professeurs, particulièrement dans des zones d’éducation prioritaire (REP). Benoît Falaize a répondu aux questions de Convoi 77.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à travailler sur ce livre ? A qui est-il destiné ?
Depuis plusieurs années, un discours sur l’école s’est installé dans les débats publics : il stigmatise
l’enseignement dans les banlieues des villes françaises, voire montre du doigt des élèves qui, par
leurs ascendances immigrées supposées ou réelles, n’adhèreraient pas à l’idéal républicain ni aux
savoirs enseignés. On ne compte plus les gros titres des livres à scandale ou des articles de presse sur
: « l’islamisation de l’école », « les concurrences mémorielles en classe », « On ne peut plus enseigner
la Shoah dans certains quartiers », etc… J’en passe, même si en faire une recension objective et
systématique permettrait de se rendre compte du niveau où se trouve le débat sur l’école en France.
Loin des esprits chagrins ou catastrophistes, nous montrons dans ce livre que, dans les banlieues, le
travail que mène l’école peut être remarquable et que la rencontre avec une horde d’élèves
salafistes relève largement du fantasme. C’est un livre de pédagogie, mais aussi politique et social.
Faisons confiance à cette jeunesse qui ne demande qu’à apprendre et à trouver sa place dans la
société. A la différence des discours déclinistes, nous proposons des choses, des solutions. (Nous
donnons à voir le travail quotidien : sa complexité et les solutions apportées. En cela, il fait
ressource). C’est un message d’espoir. Lucide, certes, mais d’espoir quand même.
De ce point de vue, le livre s’adresse bien entendu à la communauté enseignante, en donnant de
beaux exemples de réussites individuelles et collectives, notamment aux professeurs en formation,
mais aussi de manière toute aussi importante, au grand public abreuvé de discours sur les territoires
censés être définitivement perdus pour la République. A la différence des discours déclinistes, nous
proposons des choses, des solutions. C’est un message d’espoir. Lucide, certes, mais d’espoir quand
même.
Pensez-vous que l’on n’écoute pas suffisamment les élèves et les enseignants des quartiers populaires ? Si oui, pourquoi ?
C’est une évidence. Les élèves illégitimes de la société française que sont souvent les élèves de
banlieues, immigrés ou de famille immigrée souvent, rencontrent l’illégitimité des professeurs du
quotidien, ceux dont on ne parle jamais, qui n’ont pas accès aux grands médias et qui font leur travail
dans l’indifférence générale, sauf quand un incident arrive.
Dire que l’école fonctionne ou peut fonctionner à certaines conditions pédagogiques et didactiques,
cela n’intéresse pas grand monde en fait. Car la classe, tout le monde croit savoir ce que c’est, en
tant qu’ancien élève, ou en tant que parent d’élève. Mais l’école c’est un métier, des pratiques, des
savoirs, des procédures, des règles explicites et implicites. C’est aussi des postures professionnelles,
une technicité très difficilement perceptible de l’extérieur. A l’heure des débats médiatiques en
forme de punchlines, où l’argument disparaît pour le slogan ou l’invective, ce discours pédagogique
ne trouve pas sa place. Il n’est pas audible. Nous l’observons chaque jour. Les grands médias s’en
désintéressent. Et de fait, l’opinion publique y a peu accès.
L’enseignement de la Shoah est obligatoire en France depuis une trentaine d’années. Quel regard portez-vous dessus ?
Il faut se rappeler que le traitement de cette question dans l’après Seconde Guerre mondiale et
jusqu’aux années 1980 s’est faite dans l’amnésie et la confusion. La Seconde Guerre mondiale n’a été
inscrite dans les programmes du secondaire qu’à partir de la rentrée scolaire de 1962. Il a donc fallu
attendre plus de quinze ans avant d’enseigner ce conflit encore très vif dans les mémoires familiales.
Deux raisons à cela : la première est liée à la difficulté de penser Vichy dans l’immédiat après-guerre.
Au cours de cette période de reconstruction et d’expansion économiques, la réconciliation nationale
avait valeur de refuge. Une seconde raison, peut-être plus forte encore, réside dans le climat
idéologique de guerre froide. Faire classe sur le très contemporain pouvait être perçu comme une
prise de risque politique autant que professionnelle alors que s’affrontaient en France des mémoires
politiques concurrentes et antagonistes, entre gaullistes, communistes et anciens tenants de Vichy.
On voit que cette question a toujours été sensible…
Contrairement à ce qui a pu être souvent dit, le problème n’est pas que la destruction des juifs
n’était pas montrée, mais plutôt que la façon dont celle-ci était présentée constituait, avant les
années 1980, une vraie difficulté intellectuelle de transmission. L’écriture scolaire se faisait sous
l’angle de la confusion. Si l’antisémitisme du IIIe Reich est indiqué, l’approximatif est omniprésent. La
spécificité de l’antisémitisme français et vichyste est passée sous silence ; la précision des données
historiques et des chiffres est très faible ; et le mythe résistancialiste domine. Jusqu’aux années
marquées par la publication de l’ouvrage sur le régime de Vichy de Robert Paxton, les prescriptions
et les manuels de l’école française donnent une image du génocide juif mêlé aux autres massacres de
masse sans véritable distinction.
Le tournant mémoriel des années 1980 change la donne. La plupart des nouveaux manuels de
terminale parus en 1983 introduisent le génocide des juifs et le rôle de Vichy avec des extraits des
livres de Paxton, Marrus ou de Geoges Wellers. Mais il faut attendre les programmes mis en vigueur
dans les années 1990 pour que les textes officiels évoquent directement la Shoah.
Les manuels scolaires sont aujourd’hui écrits avec rigueur le plus souvent. Les enseignants sont donc
assez bien armés pour faire connaître la Shoah aux élèves des collèges et des lycées. Même à l’école
élémentaire, les programmes de 2002 ont ouvert la voie à une prise en charge de plus en plus
importante de ce sujet dans les classes de CM2.
On parle beaucoup des difficultés d’enseignement de la Shoah aujourd’hui. Quelle est votre position sur le sujet ?
Plusieurs difficultés d’enseignement se perpétuent, malgré des ressources nombreuses et de qualité.
La première contrainte est celle du temps : comment dire l’horreur en une heure ou deux du temps
scolaire ?
La deuxième difficulté tient à l’âge même des élèves. De quelle mémoire ces jeunes ont-ils besoin ?
Dans quelle histoire inscrire la Shoah ? Celle de la guerre elle-même ? Dans l’histoire de
l’antisémitisme ? Trop souvent les juifs sont ainsi exclusivement présentés dans le regard des
antisémites. Ils sont déjà objets avant même d’être victimes.
La troisième difficulté tient à l’information que les élèves reçoivent aujourd’hui sur le monde juif.
Pour les jeunes, les juifs, c’est Israël. Ils savent les Intifada, les affrontements en Palestine et dans les
territoires occupés.
La dernière difficulté est la plus fondamentale. Est-il possible de « pédagogiser » ou « didactiser » la
Shoah ? Ce livre offre un éclairage sur ces pédagogies possibles.
Désormais au programme de l’école, le débat sur l’extermination des juifs dans l’espace scolaire se
déplace et se réactualise à la fin des années 1990 et au début des années 2000, en raison du contexte
national et international. Un livre est venu alerter sur des « territoires perdus » d’une République
dans lesquels l’école serait désormais incapable de transmettre l’extermination des juifs, en raison
d’un public scolaire considéré comme rétif voire résolument hostile, ou antisémite. La thèse était que
la République perdait ses territoires, qu’elle ne pouvait pas enseigner la Shoah, qu’elle ne pouvait
plus faire classe, que les enseignants préféraient ne plus parler d’Hitler et de l’extermination des juifs
en classe, massivement, et que cela se répandait. Une République aux abois, sans repères, plongeant
dans la communautarisation. Nous montrons, quant à nous, une autre manière de regarder la
question de la pédagogie de l’histoire de la Shoah.
Mais la sensibilité de ce sujet est une vieille histoire déjà : Au début des années 1960, l’historien
Henri Michel évoquait dans un rapport au Premier ministre de l’époque sur l’enseignement de la
seconde guerre mondiale le risque de « troubler les enfants plutôt que de les instruire ». Car
l’enseignement des génocides, au-delà des questions politiques parfois encore « chaudes » (le cas du
Rwanda et de la diplomatie française reste en suspens dans les manuels scolaires) constitue une
transmission qui repousse les logiques disciplinaires dans leurs retranchements tant théoriques que
pratiques.
L’ensemble des questions soulevées par Les Territoires perdus de la république et, dans une autre
veine, les premiers éléments de recherche dont nous disposons, restent, pour une large part, encore
en débat aujourd’hui. C’est en partie à cela que répondent des articles du livre que nous venons de
sortir.
Nous continuerons à dire que l’on peut enseigner la Shoah dans les classes. Qu’il y a des réussites
pédagogiques qui ne se disent pas, quotidiennes, chaque année. Ce, alors même que les
approximations, les idées toutes faites des élèves, leurs difficultés de concentration, leur
perméabilité toujours présente, chez certains, aux discours de facilité et d’antisémitisme, et aussi la
radicalisation de certains jeunes sont amplement diffusées. Seulement, dans sa globalité, l’école ne
peut être réduite à cela. C’est notre combat que d’en montrer les réussites dont personne ne parle.
Avons-nous d’autres options ?
* »Parce que chaque élève compte » est paru aux Editions de l’Atelier.
« Territoires vivants de la République » est paru en 2018 aux éditions La Découverte.
« Histoire et mémoires à l’école de la république » est paru en 2007 chez Armand Colin.


 English
English Polski
Polski