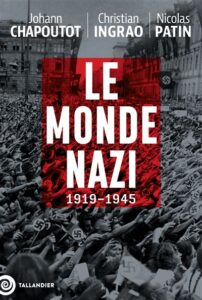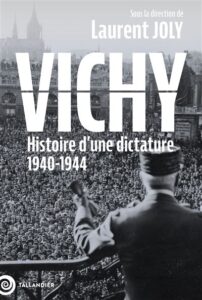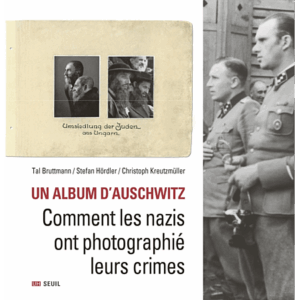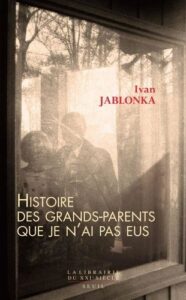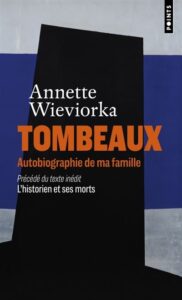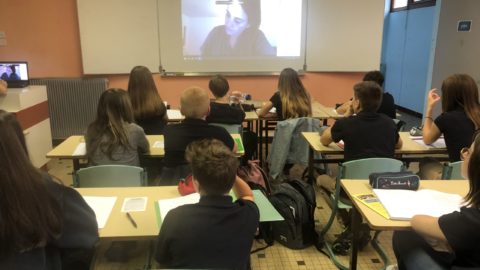Plus de 80 ans après la libération des camps et la fin du IIIe Reich, la communauté scientifique continue de s’intéresser activement à la Shoah. Nous proposons ici une revue des travaux menés à l’université et dans les instituts de recherche ces dernières années.
Au cours des vingt dernières années, d’importants travaux de recherches ont été menés. Citons ceux des historiens Christian Ingrao, Johann Chapoutot, Laurent Joly et Tal Bruttmann. Ceux-ci nous ont permis de porter un regard nouveau sur la Shoah, la déportation, le projet nazi et la collaboration.
Mais la Shoah est un sujet qui n’intéresse pas uniquement les historiens, d’autres disciplines se le sont également approprié. Ainsi, des spécialistes de littérature et d’arts se penchent-ils sur les témoignages des déportés et des survivants. Des sociologues étudient le retour des survivants et le rapport des générations suivantes à cet événement. Comme la Shoah est une expérience traumatique, elle intéresse également des psychologues. Quant aux juristes et aux philosophes, ils abordent ce génocide pour ses implications plus larges au regard de la morale et du droit. Cette variété d’approches disciplinaires aboutit à ce que la Shoah, en tant qu’objet de recherche, est observé sous des angles divers et complémentaires.
Dans les plus récents travaux, les expériences de la Shoah sont traitées au travers d’autres questionnements plus larges, comme celui des migrations, des exils, de la reconstruction, des crimes et de la justice. Les chercheurs et chercheuses travaillent aussi beaucoup, ces dernières années, sur les concepts de « violences de masse », de « violences extrêmes », de génocide et de résilience.
De nouvelles façons d’écrire l’histoire
La parole des témoins a été très étudiée, quelles que soient les formes de leurs témoignages: récits, représentations artistiques, transmission orale dans les classes… Cependant, maintenant que les voix des derniers survivants sont en train de disparaître, nous refermons « l’ère du témoin », ce qui amène à changer la manière d’écrire l’histoire de la Shoah. Nous pouvons citer deux ouvrages dans lesquels des historiens écrivent l’histoire de leur propre famille à partir d’archives familiales: Histoire des grands parents que je n’ai pas eus par Ivan Jablonka, et Tombeaux, autobiographie de ma famille d’Anette Wieviorka.
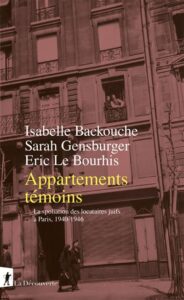 L’étude de nouvelles sources, auparavant inaccessibles, a aussi permis d’écrire des travaux inédits. Les lettres de familles juives adressées aux autorités de Vichy ont inspiré à l’historien Laurent Joly et au réalisateur Jérôme Prieur le documentaire Les Suppliques.
L’étude de nouvelles sources, auparavant inaccessibles, a aussi permis d’écrire des travaux inédits. Les lettres de familles juives adressées aux autorités de Vichy ont inspiré à l’historien Laurent Joly et au réalisateur Jérôme Prieur le documentaire Les Suppliques.
Mais aussi, dans le livre La spoliation des locataires Juifs, les universitaires Sarah Gensburger, Isabelle Backouche et Eric le Bourhis ont pris le parti de raconter l’antisémitisme sous l’Occupation par la question du logement.
Ces exemples illustrent le passage d’une écriture de l’histoire de la Shoah dans son intégralité à l’écriture de récits plus resserrés et à des études fines (ce que les universitaires appellent la « micro-histoire »). C’est aussi le cas du projet « Lubartworld » qui se propose d’écrire le destin de chaque membre de la communauté juive de la ville de Lubartów.
Des jeunes chercheurs se penchent sur le sujet
Les nouvelles générations de chercheurs et chercheuses sont loin de se désintéresser du sujet. Sur les cinq dernières années, 43 thèses ayant la Shoah pour sujet ont été soutenues en France. Voici quelques exemples:
|
Le témoignage impossible ? Écritures de la destruction des Juifs en URSS |
Le permis de tuer : la première phase de l’extermination des Juifs en Galicie orientale (22 juin-1er août 1941) |
Espace, objets, corps : les matérialités des résistances antinazies en Lituanie sous occupation allemande (1941-1944) |
|
Destruction et métamorphoses du corps dans l’enfermement. Représentation de la déshumanisation chez Primo Levi, Georges Perec et Samuel Beckett |
Et après? : une histoire du secours et de l’aide à la réinsertion des rescapés juifs des camps nazis (France 1943-1948) |
L’exil allemand à Ferramonti di Tarsia : histoires de Juifs fuyant l’Allemagne |
À ce jour, 40 thèses sont en préparation concernant la Shoah, dont:
|
Les instituteurs et institutrices face à la persécution des Juifs en France métropolitaine (1940-1944) |
La Shoah à travers les écrits intimes d’adolescents juifs européens durant la Seconde guerre mondiale |
Administrer le vol dans l’Europe nazie-fasciste. La spoliation des élites juives de Trieste et Paris (1938-1945) |
|
La pratique artistique comme outil de témoignage à valeur mémorielle du vécu traumatique des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale |
La politique contemporaine de mémorialisation de la Shoah et de lutte contre l’antisémitisme à travers les institutions françaises |
Apprendre la Shoah aux enfants : enjeux et pratiques de transmission, des années 1980 à nos jours |
Ces jeunes chercheurs et chercheuses viennent avec des questionnements et des regards neufs sur le sujet, et permettent eux aussi de renouveler les études.
La Shoah dans la production scientifique
Entre 2019 et 2025, 132 articles sur le thème de la Shoah ont été publiés dans des revues scientifiques francophones.
Une dizaine de colloques a été organisée depuis 2019 avec une thématique englobant la Shoah. Voici quelques exemples:
|
Retours de déportation 1945-1946 |
La spoliation des instruments de musique en Europe (1933-1945) |
Les Indésirables au camp de Gurs |
|
Des « Justes » face aux génocides |
Rythmer le chaos. Composition, circulation et collecte des chansons et poèmes des ghettos et des camps nazis |
Génocide. Droit et histoire du crime des crimes |
Enfin, il faut relever la création de la chaire d’excellence « Shoah et entreprises génocidaires ». Celle-ci consiste en un programme de recherches étalé sur quatre ans avec des événements et des publications scientifiques. C’est l’historienne historienne Marie Moutier-Bitan qui en a la responsabilité.
Quels soutiens financiers pour la recherche?
Dans un contexte général de réduction des budget de la recherche scientifique en France, il devient de plus en plus difficile de concrétiser un projet de recherche. Des moyens existent toutefois pour qui souhaite étudier la Shoah:
- Des institutions telles que la Fondation pour la mémoire de la Shoah financent certaines de ces thèses par des bourses de recherche.
- Plus ponctuellement, divers organismes de financement sélectionnent des projets relatifs à la Shoah, permettant ainsi de les concrétiser.
- En revanche, la DILCRAH semble avoir cessé de proposer des contrats doctoraux sur les thématiques « Racisme, antisémitisme, discriminations liées à l’origine et haine anti-LGBT », qu’elle après en avoir financé plusieurs jusqu’en 2023.
De même, plusieurs prix ont récompensé des travaux de recherche récents (les dotations financières permettent généralement leur publication en livre).
- Chaque année, le Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA) décerne le « Prix de thèse Jeanne Hersch » à un chercheur ou une chercheuse ayant « contribué à analyser au sens large les phénomènes du racisme ou de l’antisémitisme et à comprendre leurs logiques spécifiques ».
- Le « prix Maitron », très réputé en matière d’histoire sociale, a été attribué en 2024 à Sherazade Prabel pour son mémoire « Un jour je raconterai » rescapées juives d’Auschwitz, auteures de témoignages précoces, et leurs récits (1945-1996).
- La Fondation Ernest et Claire Heilbronn a remis ses prix 2025 à deux docteures. Cette fondation a été créé en avril 2018 par les descendants d’une famille déportée par le convoi n°69.
* * *
Le bilan que l’on peut retirer de ce panorama est ambivalent. Certes, des chercheurs ont produit des travaux remarquables. On note aussi un dynamisme de l’activité scientifique autour de la Shoah et de la déportation.
Cependant, le nombre de thèses soutenues sur ce sujet est en baisse. En effet, les jeunes chercheurs hésitent à travailler dessus car, dans un contexte de raréfaction des postes de recherche, le sujet de la Shoah ne semble plus permettre une bonne insertion professionnelle dans le monde de la recherche.
Pour connaitre les derniers livres publiés et des travaux scientifiques marquants sur la déportation et la Shoah, nous vous invitons à visiter régulièrement la rubrique « actualités » de notre site. Si vous êtes enseignant(e), nous publions une infolettre trois fois par an avec une veille éditoriale et des idées de pistes pédagogiques.


 English
English Polski
Polski